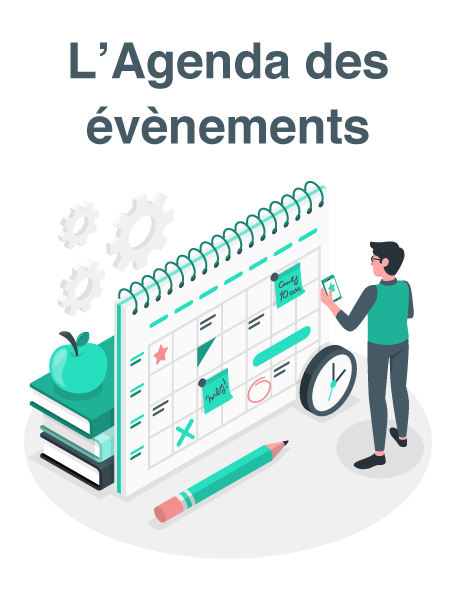Catastrophe humanitaire, sociale et environnementale, Tchernobyl a eu un impact majeur sur l’industrie nucléaire mondiale, entraînant la sortie du nucléaire de l’Italie, l’élan du mouvement anti-nucléaire en Allemagne, l’arrêt de la construction de nouvelles centrales pour un tiers de siècle aux États-Unis et une perte importante du savoir-faire au Royaume-Uni, un pays à l’origine du développement de l’industrie. Et, bien entendu, Tchernobyl a aussi détruit la réputation de la filière nucléaire soviétique. Pourtant, la Fédération de Russie, surgie des décombres de l’URSS en 1991, accorde une place de plus en plus importante à cette énergie.
35 ans après la tragédie, 20% de la production électrique russeproviennent en effet du nucléaire, dont la part dans le mix énergétique n’a cessé de croître tout au long des années 2000. La Russie est le quatrième producteur d’énergie nucléaire dans le monde, après les États-Unis, la France et la Chine. Elle est également le septième producteur d’uranium, et fabrique 17% du combustible nucléaire.
Outre son rôle clé dans la Stratégie énergétique russe, l’énergie nucléaire est un véritable levier de l’influence géoéconomique de la Russie dans le monde. Cette filière, qui est l’un des rares secteurs russes hautement technologiques à l’export (aux côtés des secteurs de l’espace et de la défense), bénéficie du soutien financier et politique de l’État, qui voit là un moyen efficace d’étendre l’influence de Moscou en Europe et ailleurs, de renforcer l’intégration de l’économie russe dans l’économie mondiale et d’améliorer l’image du pays, nettement dégradée par les multiples aventures géopolitiques du Kremlin et par son bilan domestique en matière de libertés politiques et de droits humains.
Le rôle central de Rosatom
Le moteur de cette croissance industrielle est l’entreprise publique Rosatom («Corporation nationale pour l’énergie atomique» de son nom complet), chargée de représenter les intérêts du gouvernement russe à l’étranger dans les secteurs nucléaires civil et militaire. Héritière du ministère soviétique de l’Énergie nucléaire, Rosatom a été créée en 2007 et dirigée jusqu’en 2016 par l’ancien premier ministre (aujourd’hui chef adjoint de l’administration présidentielle) Sergueï Kirienko. Ce dernier a réussi à consolider l’industrie nucléaire russe, dispersée au cours des années 1990 dans des centaines d’entreprises, sous un seul nom, qui est devenu l’une des rares «marques» russes reconnues à l’étranger.
Aujourd’hui, Rosatom contrôle plus de 400 entreprises et emploie plus de 275;000 personnes. En plus d’être un employeur recherché (et dans certains endroits du pays, unique), Rosatom est un contribuable important, ayant versé l’équivalent d’environ 3 milliards d’euros au budget en 2019.
Dans le même temps, le groupe est l’un des plus grands bénéficiaires du soutien financier de l’État pour la construction de nouvelles centrales nucléaires, en Russie comme à l’étranger. C’est aussi un bras armé de l’État russe, intégré verticalement tout au long de la chaîne de valeur: de l’extraction d’uranium, la production du combustible, la construction de centrales nucléaires et la fabrication d’équipements, l’exploitation et la maintenance, au démantèlement et à la gestion des déchets nucléaires.
Rosatom exploite à la fois la technologie nucléaire civile et militaire, contrôle le «bouton nucléaire» du Kremlin et tient la plume en matière de réglementation sectorielle. Le groupe supervise l’exploitation de la flotte russe de brise-glaces nucléaires et gère le développement de la Route maritime du Nord, qui comprend des infrastructures émergentes dans l’Arctique. Rosatom est également en charge de la coopération nucléaire à l’étranger, représentant la Russie à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ses représentants sont détachés auprès des ambassades russes à travers le monde, où ils développent des relations bilatérales avec les États fondées sur la coopération scientifique et technologique.
Même si la Russie ne peut pas rivaliser avec la Chine en termes de vitesse de construction de nouvelles centrales, son rythme constant d’un nouveau réacteur nucléaire tous les deux à trois ans est inatteignable pour l’industrie nucléaire européenne ou américaine. Cette croissance du secteur nucléaire russe a été rendue possible grâce à une politique étatique pro-nucléaire assumée. Alors que pays après pays se retirait du nucléaire suite à l’accident de Fukushima en 2011, le Kremlin n’a jamais cessé de soutenir l’industrie nucléaire nationale. Notamment pour des raisons géopolitiques: des pays récipiendaires de centrales nucléaires russes, et dépendant donc de Moscou dans ce secteur, peuvent se montrer moins enclins à critiquer le Kremlin pour son attitude internationale comme intérieure.
Début 2021, Rosatom construit 2 réacteurs nucléaires en Russie (dans le cadre du renouvellement du parc de 38 réacteurs opérationnels à ce jour) et 10 à l’étranger: 4 en Turquie (projet Akkuyu, 4.800 MW), 2 en cours de la mise en service en Biélorussie (projet Astravets, 2.400 MW), 2 en Hongrie (Paks-2, 2.400 MW) et 2 au Bangladesh (Rooppur 1 & 2, 2.400 MW).
En outre, 5 sont au stade de la pré-construction: 1 en Finlande (Hanhikivi, 1.200 MW) et 4 en Égypte (El-Dabaa, 4.800 MW). Rosatom affiche également 35 nouveaux projets de centrales nucléaires au total, qui se trouvent à différents stades de développement, notamment en Chine, en Inde, en Iran et en Arabie saoudite.
Le rôle de l’industrie nucléaire russe dans l’image du pays à l’étranger
La contribution du nucléaire à l’image russe à l’étranger comporte trois éléments essentiels.
Tout d’abord, les prêts et les garanties financières que l’État russe fournit pour la construction de centrales nucléaires par Rosatom, ce qui confère au groupe un avantage concurrentiel déterminant, même en Europe. Citons, à titre d’exemples, le prêt gouvernemental de 10 milliards d’euros octroyé à la Hongrie pour la construction de Paks-2, ou l’achat de 34% du projet de construction du réacteur nucléaire de Hanhikivi en Finlande. Quant aux pays pauvres primo-accédants au nucléaire, le financement par Moscou des projets de construction ou de recherche qui y sont menés permet au Kremlin d’étendre sa portée géopolitique au-delà de ses sphères d’influence traditionnelles (notamment en Afrique, en Amérique latine, ou encore en Asie du Sud-Est).
Le deuxième élément tient à la capacité de Rosatom à proposer une gamme complète de services d’énergie nucléaire –conception et ingénierie des réacteurs, construction, exploitation, maintenance, approvisionnement en combustible nucléaire, récupération d’uranium usé, formation des experts locaux… Ce dernier aspect est indispensable pour les pays primo-accédants comme la Turquie, l’Égypte ou le Bangladesh, qui ambitionnent de pouvoir, à terme, exploiter par eux-mêmes leurs centrales nucléaires. En outre, en tant que propriétaire de la technologie, Rosatom est un consultant clé de ses pays clients sur le cadre réglementaire de l’industrie en création chez eux.
Le troisième élément est la domination historique de la technologie nucléaire russe sur certains marchés. C’est particulièrement vrai en Europe, où les technologies des réacteurs soviétiques VVER et RBMK ont été imposées aux États satellites d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’aux républiques baltes, pendant la guerre froide. C’est cette présence historique, en plus du financement étatique, qui a facilité l’obtention par Rosatom d’un contrat de construction en Hongrie (même si la conjoncture politique a empêché Rosatom de répliquer ce modèle en Pologne ou en République tchèque).
En plus d’accroître l’influence politique de la Russie au sein de l’UE, la construction de nouvelles centrales nucléaires renforce les liens économiques entre le fournisseur russe et les pays clients européens pour les décennies à venir, avec un effet comparable à celui d’un gazoduc. Les étapes consécutives à la construction (fourniture du combustible nucléaire et d’équipements, ainsi que les contrats de maintenance) sont la véritable source de revenus (et d’emplois) pour la Russie pour les années à venir. En outre, le nucléaire permet à Moscou de co-définir le mix énergétique futur de l’Europe, ce qui peut lui donner la possibilité d’avancer ses pions sur d’autres dossiers, notamment celui du gaz.
Tchernobyl, un traumatisme surmonté?
Enfin, à travers ses projets nucléaires en Europe, le Kremlin cherche à améliorer l’image de marque du «nuke russe» aux yeux des pays de l’UE. Son implication dans le projet de Hanhikivi en Finlande s’inscrit pleinement dans cette démarche, car la Russie ne peut que bénéficier de l’association de son image à celle de ce pays européen reconnu dans le monde entier pour le haut niveau d’exigence de son régulateur nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (STUK).
Car Tchernobyl a causé un préjudice très profond à l’image du nucléaire «made-in-Russia». C’est encore vrai aujourd’hui, même si l’accident s’est produit il y a 35 ans en Ukraine soviétique et si la technologie du réacteur RBMK utilisée à Tchernobyl ne fait pas partie de l’offre de Rosatom à l’export. C’est peut-être pour cette raison que Rosatom a vivement recommandé à toutes ses équipes de visionner la fameuse mini-série de HBO…
Quant à la population, les sondages montrent qu’elle a surmonté le traumatisme de la tragédie et a réappris à aimer l’énergie nucléaire. L’accident de Fukushima a servi de piqûre de rappel : en 2011, 40% des personnes interrogées par le Centre Levada, un institut de sondages russe indépendant, estimaient nécessaire de sortir du nucléaire. Cependant, le scepticisme n’a pas perduré, car le soutien à l’atome était remonté à 72% dès 2013 et était encore de 74% en 2018…
Anastasiya Shapochkina Maître de conférences en géopolitique, Sciences Po
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons Lire l’article original sur The Conversation.