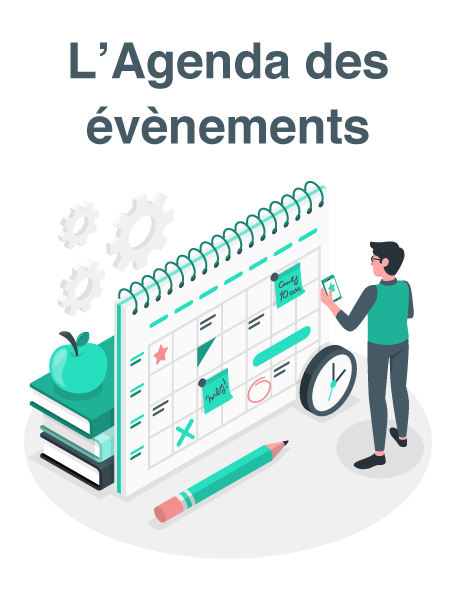«Les pays qui se sont le mieux sortis de la crise sont ceux qui ont une industrie forte», constatait Louis Gallois, ex-patron de la SNCF et d’Airbus, entre autres, dans son Pacte pour la compétitivité de l’industrie française. C’était en 2012, et l’auteur du rapport soulignait les risques pour l’ensemble de l’économie de laisser le secteur industriel se déliter et perdre ainsi un moteur de croissance et un levier de sortie de crise.
Ce constat sonne comme une évidence. Il faut croire qu’il n’en est rien, car neuf ans plus tard, en présentant son programme France 2030 pour relancer l’industrie, le Président de la République Emmanuel Macron semble le partager depuis peu: «On a longtemps pensé qu’on pouvait se désindustrialiser en continuant à être une grande nation d’innovation et de production: je crois qu’il est maintenant établi que c’est faux», a-t-il déclaré.
Des alertes de longue date
En fait, il y a bien longtemps que des voix s’élèvent pour alerter sur les dangers d’une désindustrialisation, et contestent l’hypothèse qu’une grande nation puisse tenir son rang en fondant son économie uniquement sur les services. Ainsi en 2011, les économistes, Patrick Artus et Marie-Paule Virard, dans leur livre «La France sans ses usines» établissaient la relation qui existe entre désindustrialisation, déficits extérieurs et endettement. Autant de maux dont souffrent la France aujourd’hui et qui n’ont fait que s’aggraver depuis le début du siècle, avec un secteur manufacturier qui ne pesait plus que 13% de la valeur ajoutée nationale en 2018 selon l’Insee contre 22% en 1999, et dont le décrochage est deux fois plus important que dans le reste de la zone euro. Ces économistes soulignaient, entre autres, qu’avec la désindustrialisation, une nouvelle catégorie de classes populaires émergeait, qui ne se sent représentée ni par la droite ni par la gauche. «Ainsi la désindustrialisation peut-elle être instrumentalisée comme une défaite entrainant une perte de sentiment national et le protectionnisme faire figure de dernier rempart», commentaient-ils. Un constat qui résonne étrangement dans la période pré-électorale actuelle.
On pourrait aussi multiplier les signaux lancés par des personnalités comme Edith Cresson, ex-Premier ministre qui fut aussi ministre du Redéploiement industriel et commissaire européen à la Recherche et aux technologies, mettant en garde sur la déconnexion entre la recherche et l’industrie. Or, «si on ne fait pas d’industrie, on ne fait pas de recherche», poursuivait-elle. Mais dans le même temps, à l’instar de patrons tels Serge Tchuruk à la tête d’Alcatel célébrant l’entreprise sans usines, de nombreux grands patrons, pour souscrire à des logiques financières, délocalisaient les investissements et externalisaient les productions… rassurant l’opinion en s’engageant à maintenir la matière grise et les centres de recherche en France. Ce qui, très vite, se révéla faux. De sorte que Francis Mer, ancien grand patron lui-même (notamment d’Usinor) devenu ministre de l’Economie au début du siècle, constatait amèrement: «l’industrie française n’a pas suffisamment investi dans l’innovation pour renouveler l’offre». Quand l’industrie décline, l’innovation suit. Même si, pourtant, le crédit impôt recherche -une aide fiscale à la R&D mise en place dans les années 80 pour inciter les entreprises françaises à innover- oscille chaque année autour de 5 milliards d’euros. Sans que les retombées apparaissent très clairement, au point que le dispositif est parfois controversé pour manque de ciblage.
Une conviction à forger
Aujourd’hui, c’est au tour d’Emmanuel Macron de se dire convaincu que «l’innovation technologique, l’innovation de rupture et l’industrialisation sont bien plus liées que ce qu’on le pensait jusqu’alors». A ceci près que d’autres le clament depuis longtemps, mais que les arbitrages au sommet de l’Etat n’ont pas tenu compte de leurs mises en garde… même du temps où l’actuel Président était secrétaire général adjoint du cabinet de François Hollande à l’Elysée, puis lui-même ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique avant de briguer la fonction suprême. On se souvient d’ailleurs de passes d’armes avec Arnaud Montebourg, son prédécesseur à l’Industrie, qui prônait l’interventionnisme de l’Etat pour enrayer la désindustrialisation de la France. Mais il faut croire qu’à cette époque, la conviction du Chef de l’Etat n’était pas encore forgée.
Pourtant, Nicolas Sarkozy lui-même, en intervenant notamment pour empêcher le naufrage des ex-Chantiers de l’Atlantique, avait signifié que l’Etat était légitime à assurer la pérennité de fleurons industriels. Ainsi est-il difficile de prétendre que la France, aujourd’hui, aurait plus qu’hier «un besoin impérieux d’accélérer les investissements publics créateurs de croissance, d’emplois et d’indépendance industrielle»: ce besoin s’exprime depuis longtemps, mais on avait juste choisi de ne pas l’entendre. On délaissait ainsi un modèle de croissance à l’allemande (avec une primauté donnée à l’industrie) pour lui préférer un modèle «libéral financier» selon l’expression de Jean-Louis Beffa, ex-patron de Saint Gobain, dans son livre «La France doit choisir» (modèle qui laisse le champ libre aux stratégies des marchés de capitaux). La situation de l’industrie en France n’est ni une surprise, ni une fatalité.
Des secteurs d’excellence qui ne le sont plus
L’ambition du plan France 2030 est immense. Pour l’Elysée, il s’agit «d’accompagner les transitions de nos secteurs d’excellence : énergie, automobile, aéronautique ou encore espace» afin de permettre à la France de retrouver le chemin de son indépendance énergétique, environnementale, industrielle, technologique, sanitaire et culturelle et de prendre un temps d’avance dans ces secteurs stratégiques. Ambition d’autant plus louable que certains de ces secteurs ne peuvent plus prétendre à l’excellence. La France a perdu son expertise et son avance technologique dans l’énergie nucléaire en stoppant des programmes innovants comme Superphenix puis Astrid, l’automobile est devenu un secteur quasi sinistré à l’image de la sidérurgie du siècle dernier, et l’aéronautique doit relever les défis de la transition écologique. Après avoir tant tardé à prendre les alertes en considération, il est urgent d’intervenir pour mettre en place les conditions d’un rebond.
France 2030, après les grands emprunts de 2009 et 2013
Doté de 30 milliards d’euros, le plan France 2030 est un bon vecteur de communication. Mais au-delà de l’effet d’annonce recherché, est-ce approprié? En 2009 déjà, Nicolas Sarkozy, Président, avait annoncé le lancement d’un Grand emprunt de 35 milliards d’euros destiné à soutenir l’investissement dans les filières innovantes. François Fillon, alors Premier ministre, prédisait une «accélération de l’innovation du nucléaire de quatrième génération, de la voiture de demain»… Le programme avait reçu le soutien de deux anciens Premiers ministres, Alain Juppé et Michel Rocard. Et une fois François Hollande parvenu à l’Elysée en 2012, Arnaud Montebourg avait eu pour mission de boucler les objectifs de ce grand emprunt. Mieux: En 2013, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de François Hollande, compléta l’emprunt Sarkozy par un nouveau grand emprunt à 12 milliards d’euros, ciblant plus particulièrement le numérique, la transition énergétique, la santé, et les grandes infrastructures de transport. Ces secteurs industriels avaient manifestement besoin des deniers publics pour se développer.
Mais on reste dubitatif. A en croire la situation actuelle, ces aides n’ont pas atteint leurs objectifs. Malgré plus de 47 milliards d’aides publiques (pour ne parler que des grands emprunts) déversées depuis un peu plus de dix ans, le nucléaire et l’automobile comptent toujours au nombre des secteurs à secourir, les activités dans le numérique (notamment dans les composants) sont à la traîne dans le monde, la transition écologique a du mal à dépasser le stade des incantations et la pharmacie a montré sa vulnérabilité à l’occasion de la crise du Covid.
Un problème de méthode et de culture
Ainsi, les 30 milliards d’euros de France 2030 n’apparaissent-ils pas comme une manne énorme pour l’industrie en général au regard des sommes qui sont déjà venues renflouer des secteurs sans déboucher forcément sur des résultats probants. Surtout si le danger d’un saupoudrage n’est pas écarté, ce qui -en ciblant l’énergie, les transports du futur, l’alimentation, la santé, l’espace et les fonds marins- semble bien être le cas et nuira à l’efficacité du dispositif. Le gouvernement et celui qui lui succédera devra se montrer parcimonieux pour répartir une enveloppe pas aussi épaisse qu’il apparaît, pour espérer engranger des résultats plus perceptibles que par le passé.
Les clés de la réussite sont aussi dans le mode d’attribution des enveloppes et les structures par lesquelles les aides en question seront attribuées. Or, des critiques se sont élevées par le passé, par exemple sur les bénéficiaires des Codevi (avant leur transformation en livret de développement durable solidaire) captés par de grosses entreprises alors qu’ils étaient avant tout destinés aux PME/PMI. De même sur l’utilisation par les entreprises des sommes provenant du CICEsuspectées d’être en partie redistribuées aux actionnaires alors qu’elles étaient destinées à l’investissement et à l’emploi. Rien n’est plus volatil que des aides…
Enfin, les obstacles à surmonter sont aussi de nature culturelle. Considérant les sommes qui échappent au fisc en se réfugiant dans des paradis fiscaux, des observateurs constatent: «dans l’industrie rien n’est permis, mais dans la finance rien n‘est interdit. Il faut alléger les contraintes spécifiques qui pèsent sur l’industrie». Les dirigeants, comme le personnel politique, possèdent rarement une culture scientifique ou industrielle. Et ils se révèlent trop focalisés sur le court terme, à cause du diktat des retours sur investissements, alors que le temps de l’industrie qui implique recherche et mise en production est forcément long. Sans oublier la formation, souvent perçue comme une dépense alors qu’il s’agit d’un véritable investissement et que l’expertise à tous les niveaux est le principal actif d’une entreprise.
Pour consolider un plateau industriel à partir duquel reconstruire après toutes ces années à développer les activités de services, c’est une véritable révolution à mener jusqu’au sommet de l’Etat. Pour que ne se renouvellent pas les échecs subis dans l’aluminium, l’acier, les télécoms ou le ciment après les déboires de Pechiney, d’Usinor, d’Alcatel ou de Lafarge qui figuraient pourtant parmi l’élite mondiale. Plus récemment, en 2015, la vente des activités d’Alstom dans l’énergie à l’américain General Electric avait été perçue comme un nouvel échec. Cette cession qui avait eu les faveurs d’Emmanuel Macron alors au secrétariat général de l’Elysée, pourrait maintenant être remise en question par le rachat en sens inverse du nucléaire de l’ex-Alstom par EDF. Assisterait-on au début d’un renversement?
Gilles Bridier