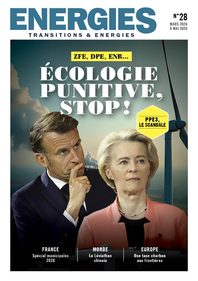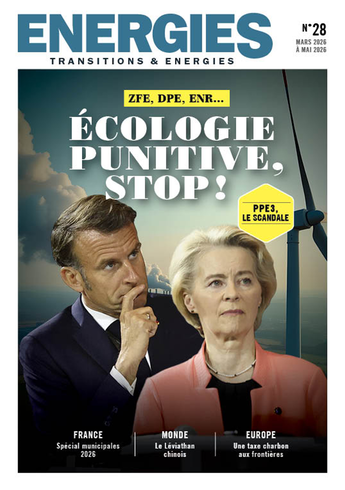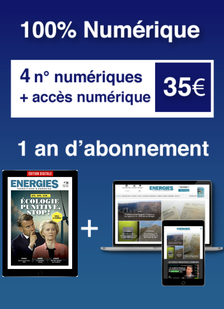Le modèle allemand de la transition, la fameuse Energiewende que les institutions européennes ont cherché à imposer à l’ensemble des pays de l’Union, est un échec. Les Allemands sont les premiers à le dire. Le pays a dépensé plus de 600 milliards d’euros sans atteindre ses objectifs de décarbonation et avec des prix de l’électricité qui sont devenus les plus élevés d’Europe. La priorité totale donnée aux renouvelables intermittents, éolien et solaire, et l’abandon dans le même temps du nucléaire ont rendu l’Allemagne encore plus dépendante de ses centrales à charbon qui crachent massivement du CO2 et des particules fines dans l’atmosphère. Le charbon a produit 22,5% de l’électricité du pays l’an dernier. Il faut bien de l’électricité quand il n’y a pas de vent ou pas de soleil. Ou quand il est impossible d’acheminer au sud du pays l’électricité produite par les parcs éoliens qui se trouvent au nord.
Car comme l’Espagne qui en a payé le prix par un Blackout le 28 avril dernier, l’Allemagne n’a pas modernisé son réseau électrique pour s’adapter aux productions renouvelables éparpillées sur son territoire et intermittentes et doit y consacrer des centaines de milliards. Pour finir, le remplacement des centrales à charbon par des centrales à gaz alimentées par la Russie s’est effondré avec l’invasion de l’Ukraine en février 2022 et la destruction des gazoducs NordStream 1 et 2 quelques mois plus tard.
Une industrie lourde asphyxiée par les coûts de l’énergie
Il a fallu quelques années à l’Allemagne pour tenter de trouver une autre stratégie énergétique après avoir été prise notamment par le mirage de l’hydrogène vert. Mais le temps presse et l’existence même de l’industrie lourde allemande, asphyxiée par les coûts de l’énergie, est en jeu. Garantir un approvisionnement énergétique fiable et relativement abordable pour le secteur manufacturier est une promesse phare de la coalition du nouveau chancelier conservateur (CDU), Friedrich Merz.
La solution envisagée est à double détente. La première a été d’obtenir la possibilité auprès de la Commission européenne de subventionner la consommation d’électricité au-delà d’un prix plancher de 50 euros le MWh. Le contribuable allemand pourra ainsi financer la survie de son industrie et effacer l’un des rares avantages comparatifs qu’il restait à la France par la grâce de son parc nucléaire. Un avantage qui de toute façon est en passe d’être gommé par la PPE3 (Programmation pluriannuelle de l’énergie troisième version) qui prévoit un doublement des capacités de production éoliennes et un triplement des capacités solaires d’ici 2035. Tout cela coûtera 300 milliards d’euros à un pays financièrement exsangue et fera doubler la facture d’électricité des ménages.
Reproduisons un modèle qui est un échec en Allemagne tandis que nous n’avons pas besoin de produire d’électricité, nous en produisons en surabondance que nous exportons massivement, et notre production est décarbonée à 95%… Cherchez l’erreur !
Pas d’autre choix
Pour en revenir à l’Allemagne, l’autre issue proposée par le gouvernement a un problème majeur passe toujours par le gaz naturel qu’il faudra importer massivement. Plus de Russie évidemment, mais des Etats-Unis et du Qatar sous forme de GNL (Gaz naturel liquéfié) qui coûte très cher et dont l’empreinte carbone est très élevée, certains disent équivalente presque à celle du charbon. Mais peu importe, les opinions ne le savent pas. Car le GNL doit être liquéfié à -161 degrés Celsius pour être transporté par méthanier et regazéifié à son arrivée dans les terminaux, ce qui entraîne une consommation considérable d’énergie. Et ce GNL est très souvent du gaz de schiste américain dont l’exploitation est nocive pour l’environnement et émet beaucoup de méthane, puissant gaz à effet de serre, dans l’atmosphère.
Mais n’ayant pas vraiment le choix, le gouvernement allemand a donc décidé de remplacer la puissance installée de ses centrales à charbon et au lignite (un charbon de très mauvaise qualité encore plus polluant) de 30 GW et de construire 20 GW de centrales à gaz (une quarantaine de centrales) à ajouter aux 35 GW existants. Dans le nouveau plan allemand concocté par le gouvernement du chancelier Friedrich Merz il n’est plus question de l’engagement fantaisiste de la coalition précédente SPD (socialiste) et vert de pouvoir transformer, un jour, ses nouvelles centrales pour qu’elles fonctionnent à l’hydrogène.
Un système électrique précaire
Sur le fond, cela ne règle pas vraiment le problème. Le système électrique allemand compense difficilement l’intermittence du solaire et de l’éolien en additionnant des sources pilotables, qui peuvent elles répondre à la demande indépendamment de la météorologie, hydroélectricité, charbon, gaz, biomasse et pétrole qui font un total de 100 GW de capacités. C’est-à-dire exactement la même qu’il y a 20 ans quand a été lancée l’Energiewende… Et en plus l’Allemagne recourt fréquemment à ses voisins, notamment la France, pour leur acheter de grandes quantités d’électricité nucléaire… maudite. C’est surtout le cas quand il y a peu de vent comme au début de l’année marqué par une période de « dunkelflaute » (calme plat), de plusieurs mois.
L’Allemagne doit officiellement fermer sa dernière centrale à charbon et sa dernière mine de lignite d’ici à 2038, dans 13 ans. Les paris sont ouverts pour savoir s’ils seront capables d’y parvenir… On peut toujours en douter.