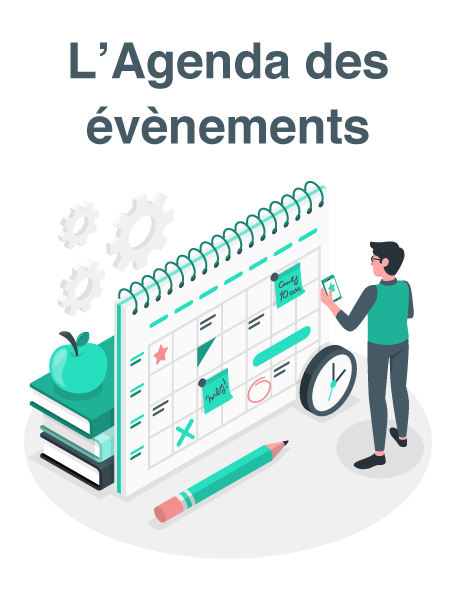On a coutume de dire que la sûreté du nucléaire n’a pas de prix, cela signifie qu’on ne doit pas mettre de bornes aux objectifs de sûreté, ni à la sévérité des contrôles. De ce point de vue, on ne peut que se réjouir de la rigueur de l’Autorité sûreté nucléaire (ASN) en France, fondée sur son indépendance vis-à-vis de l’état et de l’exploitant. L’EPR, base du nouveau nucléaire, atteint un niveau de sûreté jamais atteint, tandis que les réacteurs existants se voient appliquer le principe d’amélioration continue de la sûreté, notamment lors de leur rénovation à 40 ans. Mais, devant les coûts que tout cela entraîne, on pourrait se demander si on n’en fait pas un peu trop, ce qui, il est vrai, est une question taboue dans notre monde de l’émotionnel et de la bien-pensance. Osons tout de même sortir un peu du périmètre étroit de la pensée précautionniste qui ne tolère que le risque zéro. Qui d’ailleurs n’existe pas quelles que soient les activités humaines.
Pour l’EPR, les normes de sûreté très élevées, qui ont conduit à sa complexité très pénalisante, ainsi que les pratiques de contrôle particulièrement sévères de l’autorité de sûreté (dont l’application rétroactive de changements des normes et des procédés de contrôle), ont été une des sources majeure du retard de dix ans et de l’explosion du devis passé 3 à 13 milliards d’euros (soit 8 000 €/kW). Elles ont amplifié les difficultés de réapprentissage de l’industrie nucléaire. Le coût de production s’établirait à 110 €/MWh, très au-dessus de celui des installations éoliennes à terre ou solaire PV (45-55 €/MWh) (tels qu’on les présente en se gardant bien, au passage, de prendre en compte les coûts croissants de système et ceux de la désoptimisation du mix électrique). Ce qui conduit les décideurs à douter de l’intérêt économique du nouveau nucléaire.
On les voit bien ces doutes quand les pouvoirs publics ne défendent avec aucune conviction l’originalité de la politique française de mix électrique à dominante nucléaire, quand des ministres commandent des scénarios 100% renouvelables pour se démarquer de l’option nucléaire et quand des agences publiques (Ademe, RTE) ratiocinent à l’infini sur la façon de réduire la part du nucléaire au-delà de 50% après 2035.
On voit aussi cette mise en question de la compétitivité du nucléaire (ou de sa perception), même à propos des réacteurs existants rénovés à 40 ans avec l’augmentation très importante du coût de cette rénovation, en raison du rehausse- ment de leur niveau de sûreté décidé par l’ASN, en application d’un principe d’amélioration continue de la sûreté… qui ne figure nulle part dans la législation.
Aux Etats-Unis, on se contente du maintien du niveau de sûreté d’origine car il n’y a pas de tabou à s’interroger sur l’efficacité des mesures et leur coût. Les réexamens tous les vingt ans visent à s’assurer avant tout que les effets du vieillissement des équipements sont anticipés. Dans cette logique, 90% des réacteurs ont déjà été autorisés à fonctionner jusqu’à 60 ans, et deux jusqu’à 80 ans. En France, lors de la visite décennale à 40 ans, en plus de la rectification des écarts au référentiel de sûreté de départ et la correction des effets du vieillissement, le programme du grand carénage comprend des modifications importantes permettant de se rapprocher le plus possible des niveaux de sûreté de l’EPR avec la réduction d’un facteur 10 de la probabilité d’un accident de dimensionne- ment avec relâchement de radioactivité.
Un exemple de mesures coûteuses visant ce dernier risque est l’adjonction d’un dispositif de récupération du corium par renforcement du radier. En France, à force d’introduire de nouvelles exigences pour la rénovation à 40 ans, le coût de ré- novation par réacteur exposé dans les rapports parlementaires ou de la Cour des comptes, est passé de 300 millions d’euros en 2009 à plus de 1,2 milliard en 2020, ce qui porte la charge financière annuelle du grand carénage à 4,3 milliards d’euros pour EDF (le tiers des investissements annuels). Ce coût par réacteur est tout de même équivalent au coût initial d’investissement des REP 900 (2,5 milliards de francs en 1978 à corriger d’une inflation cumulée de 380%). Il ressort de cette évolution que les tenants du 100% EnR en sont à arguer que cette rénovation ne se justifie plus pour des raisons économiques. Autant arrêter les réacteurs le plus tôt possible pour faire place aux EnR qu’ils présentent comme compétitives avec le nucléaire existant rénové. Peu importe que ce soit le cas (il faut savoir que si l’on raisonne de façon économique et non comptable, la rénovation reste très rentable à 33 €/MWh par rapport aux EnR intermittentes). L’important est que le montant de la dépense pour la rénovation de chaque réacteur frappe les esprits.
Devant la mise en question de la compétitivité du nucléaire qui s’ensuit ou, à tout le moins, devant la perception que les décideurs peuvent en avoir sous l’influence de la bien-pensance actuelle, on peut se demander si les réacteurs français qui sont très sûrs ne le sont pas un peu trop. Du point de vue de l’économiste, en voyant la compétitivité du nucléaire mise en question par l’internalisation sans limite des externalités environnementales au point qu’il devrait s’effacer totalement devant les autres moyens de production électriques, on ne peut qu’en déduire que cette internalisation révèle un défaut de rationalisation économique. Aux états- Unis, comme dans d’autres pays, dont le Royaume Uni, où la préoccupation de la sûreté est au moins aussi importante qu’en France, les démarches de sûreté sont plus rationalisées et pragmatiques car, pour chaque mesure prise, les gains en termes de maîtrise des risques sont mis en balance avec leurs coûts pour les exploitants.
Un autre point à considérer est le mode d’action de l’autorité de sûreté quand il est coupé des réalités industrielles tant pour la définition des normes que leur application. On doit se demander en effet si le mode de contrôle de l’ASN procédurier et sans appel n’est pas contreproductif, notamment en contraignant trop fortement les dynamiques industrielles.
À partir d’un certain seuil, la sécurité n’est plus améliorée
Contenir les risques a un prix. La question est alors de savoir comment déterminer le niveau d’effort optimal, dans une perspective de rationalité selon laquelle le gain en termes de réduction des risques est mis en balance avec son coût pour l’exploitant et pour les consommateurs d’électricité. Mais en France où il n’y a pas de seuils de précaution définis par la loi, on ne pose pas cette question ainsi. On suit une approche purement qualitative, sans considération ni pour le bénéfice social de chaque mesure en termes de réduction du risque et des dommages, ni pour son coût pour l’exploitant et au-delà, pour les consommateurs d’électricité.
Certes on applique le principe universel ALARA (As Low As Reasonnably Achievable), mais c’est par l’approche déterministe qu’on le fait, qui est très éloignée du pragmatisme prudent basé sur l’approche probabiliste et l’analyse coût-bénéfice adoptées aux Etats-Unis, suivis par la Grande-Bretagne. L’approche déterministe consiste à lister les accidents plausibles et fixer des règles pour les éviter, sans considération de la probabilité de ces accidents, de leurs dommages et du coût du respect de ces règles. Cela conduit à faire le maximum réalisable techniquement en ajoutant mesure sur mesure tant que c’est techniquement possible en alimentant l’irréversibilité de l’accroissement des exigences de sûreté en véritable effet-cliquet. Cette tendance est d’autant moins endiguée en France qu’il n’existe pas d’objectifs quantitatifs fixés par la loi, ni d’analyse avantages-coûts, contrairement aux Etats-Unis et au Royaume Uni. Or, cette tendance n’est pas sans effets pervers vis-à-vis même de l’objectif poursuivi.
Dans son Traité des libres qualités (PUF, 2019) sur la normalisation de la qualité dans tous les domaines et toutes les directions, Pascal Chabot analyse l’expérience de plusieurs secteurs industriels présentant des risques technologiques, en montrant que le fait d’ajouter des mesures ou de les ren- forcer continument n’améliore en rien la sécurité à partir d’un certain seuil, au contraire. Si elles sont mal comprises par les industriels, le risque est grand qu’elles soient mal intégrées et mal appliquées, voire que les procédures de contrôle soient détournées. C’est ce qui est arrivé dans le cas du nucléaire avec les contractants d’EDF, Framatome (Areva NP à l’époque) et ses sous-traitants lors de la fabrication et des contrôles-qualité des composants de l’EPR ou des générateurs de vapeur de REP existants, avec des normes exagérément exigeantes et la débauche de contrôle qui a conduit à la falsification de nombre de bordereaux de contrôle à l’usine du Creusot.
Aux Etats-Unis, pays qu’on peut prendre comme référence en matière de sûreté nucléaire malgré quelques déficiences, les principaux objectifs de sûreté sont précisés par la loi de façon quantifiée (par exemple un objectif de probabilité maximale de fusion de cœur inférieur à 10-4 par année réacteur, et de limitation de largage massif de radioactivité dans l’environnement de 10-6). La Nuclear Regulatory Commis- sion (NRC) cherche à rationaliser ses actions en alliant la rigueur à la maîtrise des coûts dans la poursuite de ces objectifs. Depuis 1984, elle travaille sur la base d’analyses probabilistes en comparant le bénéfice des mesures à prendre (la réduction du risque d’accident en termes de probabilité et de ses dom- mages) avec leur coût pour les exploitants. La NRC fixe ainsi des normes de performances «risk informed and performances based» basées sur l’approche probabiliste chaque fois que le risque et les dommages évités peuvent l’être. Dès lors qu’on est capable d’évaluer les probabilités, dimensionner les équipements sur la base des contraintes maximales de pression, corrosion, température, poussée sismique, ne se justifie plus. Cette démarche présente aussi l’avantage de se concentrer sur ce qui est important, et même dans certains cas, à baisser les exigences de certaines mesures. La quantification des objectifs permet aussi leur contrôle par les parties prenantes. Les exploitants peuvent contester les décisions de la NRC devant les tribunaux s’ils considèrent qu’on leur impose des mesures dont les coûts dépassent l’évaluation du bénéfice social en termes de réduction des risques, ce qui est arrivé à quelques reprises.
L’ASN obéit à sa seule logique sans hiérarchiser, sans rationnaliser et en mettant tout sur la place publique
En France, le politique s’est bien gardé de fixer de seuils précis. Le principe d’amélioration continue de la sûreté n’est inscrit nulle part dans la loi d’ailleurs. L’ASN fixe les contraintes en toute indépendance et sans vraiment regarder la facture. Sans principe de rationalisation des décisions, on considère implicitement que la sûreté nucléaire n’a pas de prix, ce qui revient à définir des normes et des règlements sans préoccupation d’efficacité et de coûts. En l’absence d’objectifs quantifiés, le régulateur ne procède à aucune hiérarchisation des questions à gérer, que ce soit pour les mesures qu’il veut prendre, et les écarts au référentiel de sûreté de l’exploitant auxquels il s’attaque et qu’il met systématiquement sur la place publique sans relativisation au nom du devoir de transparence (voir plus loin).
Sans objectifs quantitatifs, sans rationalisation, son pouvoir discrétionnaire est grand. Il peut exiger des efforts très ambitieux d’amélioration continue de la sûreté, comme il peut imposer ad libitum des contrôles procéduriers sur la qualité des fabrications. Cela concerne notamment les points d’arrêt pour contrôle en cours de fabrication. Par exemple, sur le flying wheel de la pompe principale du primaire de Flaman- ville 3, l’ASN a imposé 17 points d’arrêt alors que pour ceux destinés aux deux EPR de Taïshan fabriqués en France, l’autorité chinoise n’en a fixé que quatre. Dans cette même logique discrétionnaire, l’ASN peut modifier un règlement sur un composant sans avoir à le justifier, même si la pièce a été entretemps fabriquée, comme ça a été le cas du contrôle de la teneur en carbone sur les parties de la cuve de l’EPR peu soumises aux irradiations (couvercle et fonds de cuve). De même, elle peut décider de changer les procédés de contrôle comme dans le cas du contrôle des soudures du circuit secondaire (passage de contrôle visuel et par tirs radiographiques à des contrôles par ultrasons type échographie).
Dans le cas de la rénovation des réacteurs existants, le principe du progrès continu de la sûreté fait apparaître la sûreté de ceux-ci comme jamais suffisante. Aux Etats-Unis, du fait de l’influence de l’analyse probabiliste et de l’approche coût-efficacité, il n’y a pas ce principe totémique de la sûreté à tout prix. Comme on l’a dit, on se contente du maintien du niveau de sûreté d’origine car il n’y a pas de tabou à s’interroger sur l’efficacité d’une mesure. On retrouve ces différences d’approche sur les mesures post-Fukushima. En France l’approche a concerné cinq domaines : la dépressurisation de l’enceinte de confinement, la source d’eau ultime en complément des moyens existants, l’amélioration de la protection du site contre les inondations et les séismes (avec réévaluation des risques), l’installation de groupes électrogènes d’ultime se- cours en cas de perte totale des moyens de secours électriques existants, et l’installation de locaux de gestion de crise avec le développement d’une force d’intervention rapide. Aux états- Unis, les changements ont porté principalement sur les deux dernières mesures, avec un ensemble d’actions pour faire face aux événements extrêmes (diesel de secours mobile, équipe d’intervention d’urgence), auxquelles se sont ajoutées l’installation de trappes à hydrogène dont les PWR (ou REP) n’étaient pas encore équipés et celle d’instruments de contrôle des piscines d’entreposage, laissée à la discrétion des exploitants d’ailleurs. Au bout du compte, les mesures post-Fukushima auraient coûté 15 fois plus cher en France par réacteur qu’aux Etats-Unis (200 millions d’euros environ contre 15 millions d’euros). Autre exemple révélateur du précautionnisme français post-Fukushima: au lieu de prendre en compte les crues ou les séismes des mille dernières années en appli- quant une marge de sécurité pour évaluer les défenses d’un site, on en est venu à considérer les catastrophes naturelles sur une période de… dix mille ans. Cela a concerné en particulier les réacteurs de Tricastin dont la production a dû être inter- rompue sur ordre de l’ASN en période de pointe d’hiver fin 2017 pour renforcement de la digue trop longtemps retardé par l’exploitant, après que les études ont montré la nécessité de ce renforcement de la protection du site en cas de séisme répondant à ce critère.
L’ASN toujours incité à démontrer à l’opinion publique son indépendance
Le jeu social autour de la sûreté nucléaire est structuré par la loi TSN de 2006 (loi relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire) qui crée l’ASN, qui confère une mission d’information en vue d’assurer la transparence complète sur les incidents, les écarts au référentiel de sûreté et toutes les décisions prises, avec des consultations publiques pour chacune, même les plus anodines. On ne retrouve pas pour l’US NRC et l’ONR (Office of Nuclear Regulation) britannique un devoir d’information et de communication aussi poussé. Ce devoir d’informer amplifie les incitations de l’ASN à montrer son indépendance en cas de désaccord avec l’exploitant. Ce qui conduit à un jeu biaisé avec l’opinion publique au détriment de ce dernier en mettant sur la place publique chaque reproche fait à l’exploitant, même les plus anodins. Contrairement à la communication de l’US NRC, jamais l’ASN ne souligne le caractère mineur des risques associés à tel ou tel écart au référentiel de sûreté qu’elle pointe et que les medias, même les plus sérieux, vont se plaire à mon- ter en épingle. Elle a appris ainsi à s’appuyer sur l’opinion publique qu’elle sait gagnée a priori à sa cause, dans le but de créer un rapport de forces avec ce dernier, qui lui-même a dû apprendre à ses dépens qu’il ne faut surtout pas argumenter publiquement.
En fait d’opinion publique, il s’agit d’abord des médias en grande majorité sceptiques sur le nucléaire depuis Fukushima, et surtout de la nébuleuse hostile au nucléaire particulière- ment bruyante à côté d’un marais de modérés plutôt silencieux (comme c’est au passage le cas dans tout domaine controversé, selon Gerald Bronner, sociologue des croyances collectives et des controverses). Tout opposant, patenté habitué des medias ou non, ne peut qu’être satisfait de voir l’ASN mettre tous les problèmes sur la place publique et sans aucune hiérarchisation. Chacune de ses annonces démontre qu’on n’est jamais assez prudent, que le nucléaire sera toujours dangereux, qu’il faut sans cesse ajouter des normes aux normes, et que les contrôles de l’exploitant ne sont jamais assez stricts. Au bout du compte, avec l’aide de l’instance de contrôle de la sûreté nucléaire, les opposants qui crient en chœur à chaque « méfait » de l’exploitant vont peut-être arriver à leurs fins en encourageant l’instance de contrôle du nucléaire à accumuler les précautions, l’objectif étant d’asphyxier le nucléaire et sa compétitivité. Ce qui est notre préoccupation dans cet article.
La disparition de tout dialogue technique
La détermination du niveau d’effort optimal ne peut que se dégager d’un dialogue effectif qui ne peut s’instaurer et se maintenir que si l’autorité ne s’enferme pas dans les procédures et les règlements qu’elle décide en se plaçant volontiers dans des situations sans possibilité de revenir en arrière, comme elle se le condamne avec ses annonces publiques. De- puis l’institution de l’ASN en autorité administrative indépendante, on observe son éloignement des réalités industrielles, comme c’est le cas pour la teneur en carbone du couvercle de la cuve de Flamanville 3, celle des calottes des générateurs de vapeur d’une quinzaine de réacteurs ou des soudures des tuyauteries du circuit secondaire et très récemment de celles des piquages du circuit primaire. Au-delà des insuffisances condamnables du contrôle qualité des sous-traitants de Framatome et de la surveillance exercée par EDF, il n’y a pas eu de discussion d’ingénieurs autour de l’innocuité de se situer en deçà de la norme par rapport au but recherché (respecter la garantie de tenue sur la durée de vie de l’équipement). En prenant le cas des soudures du circuit secondaire, des ingénieurs spécialistes confiaient en 2019 que « même si les normes de départ n’ont pas été respectées, les calculs ont montré qu’il y avait des marges suffisantes avec des soudures telles qu’elles ont été réalisées » tandis que le président de l’ASN arguait que l’on savait réaliser auparavant des soudures avec ce niveau de qualité recherché dans les réacteurs N4 de Civaux et qu’on aurait dû savoir le faire, mais sans ajouter que les moyens de contrôle de leur qualité, il y a quinze-vingt ans, n’étaient pas du tout les mêmes. Tout ça pour justifier la définition et le maintien de l’exigence de très haute qualité de ces soudures (Voir Transition & Énergies n° 2, p. 28).
Le problème a été nourri par l’incompréhension de l’exploitant, le constructeur et ses sous-traitants, de ce que signifiait la nouvelle indépendance de l’ASN dans toutes ses dimensions, notamment le devoir d’assumer en totalité la responsabilité de la sûreté nucléaire en France, alors qu’avant 2006, lorsque l’institution de contrôle de la sûreté était une direction ministérielle, cette lourde responsabilité pouvait être assumée par le pouvoir politique. Cela explique d’un côté la judiciarisation à grande échelle de la sûreté nucléaire et le développement très important des règlements parce que l’autorité cherche à se couvrir au maximum. Mais cela explique aussi l’impossibilité pour elle de laisser passer les manquements au respect des contrôles (dont les falsifications des rapports), comme les manquements au devoir d’informer rapidement l’ASN, car ils sont vécus comme des défis à son autorité, entraînant sa perte de confiance vis-à-vis de l’exploitant. Dans de telles conditions, Il n’y a plus eu progressive- ment de possibilités de dialogue technique entre l’exploitant et le constructeur en cas de problème, comme c’était encore le cas avant 2010.
L’absence de forces de rappel
Alors que la notion d’autorité n’est pas synonyme de coercition et englobe la possibilité de dialogue équilibré avec le contrôlé, le rôle de l’autorité s’est transmué en celui de gendarme (ce que les médias n’ont pas manqué de demander en appelant l’ASN le gendarme du nucléaire). C’est ce que montrent son comportement procédurier et ses décisions sans appel et depuis peu, ses sanctions comme celle du remplace- ment du couvercle de la cuve de Flamanville 3 qui ne s’imposait aucunement aux dires de bien des experts. Le problème est que le gendarme est aussi celui qui définit les règlements, celui qui procède à leur contrôle selon les modalités qu’il a définies, et celui qui peut faire plier le contrôlé en s’appuyant sur les médias et l’opinion publique qu’il sait acquis à sa cause (les journalistes ne manquent pas de saluer les décisions de l’ASN qui sont coûteuses pour EDF comme le prix de la confiance au nucléaire). Le problème est qu’il n’y a pas de force de rappel et de contrepoids institutionnel à son pouvoir protéiforme, contrairement à ce qu’on observe aux Etats-Unis.
Pour asseoir la légitimité des décisions d’une autorité in- dépendante, celle-ci devrait être placée sous une supervision effective des instances politiques et juridiques. Elle devrait avoir à rendre des comptes. Aux Etats-Unis, cela se fait par le contrôle parlementaire avec auditions contradictoires, et par les possibilités de recours des exploitants devant les tribunaux sur une nouvelle régulation au même titre que les autres parties prenantes (ONG, gouverneurs hostiles au nucléaire). En France, de par sa position d’exploitant unique qui contraste avec les trois dizaines d’exploitants aux Etats-Unis, EDF déjà suspecte ne peut guère contester les décisions de l’ASN devant le Conseil d’état, alors que les ONG opposées au nucléaire le font sans hésiter. Quant au contrôle parlementaire sur l’action de l’ASN, il y en a un exercé par l’OPECST et ses auditions mais il s’exerce dans la relative indifférence des parlementaires sur ce sujet très spécialisé.
Qu’on nous comprenne bien. Il s’agit ici de plaider pour un moindre rigorisme de l’autorité de sûreté nucléaire française qui est par trop éloignée des réalités industrielles et pour un plus grand équilibre des pouvoirs. On peut bien sûr nous rappeler que tout n’est pas parfait aux Etats-Unis, notamment dans les relations de la NRC avec les exploitants. Mais on peut tout de même considérer que ce type de relations permet une meilleure rationalisation des décisions qu’en France, sans parler des forces de rappel que constitue l’accountability (le fait de rendre des comptes) dans le système américain qui limite l’inclinaison des bureaucraties à la surrèglementation et à l’autoritarisme.
On peut aussi rétorquer que l’ASN ne fait que son métier de contrôleur en édictant des règles les plus exigeantes et en les faisant respecter car quand une règle est définie, on se doit de la respecter, même si elles sont irréalistes et inutile- ment exigeantes comme la teneur en carbone de l’acier des équipements sous pression, régi par l’arrêté ENSP de 2005. On peut aussi pointer les responsabilités de l’exploitant, du constructeur et de ses sous-traitants sur de nombreux cas, mais en partie liée à la bureaucratisation croissante du contrôle de la sûreté nucléaire. Tout cela ne doit pas empê- cher de s’interroger sur l’absence de rationalisation de chaque mesure, sur l’accumulation des normes et des règles sans définition de priorités, sur les changements des modes de contrôle après fabrication des pièces, bref sur les pratiques de l’ASN et l’intransigeance qu’elle s’autorise parce qu’elle se sent légitime à agir en faveur de la sécurité du nucléaire à tout prix, sans que personne n’ose vraiment contester ce principe. On peut aussi s’interroger sur le devoir de transparence de l’ASN, car elle lui sert pour s’appuyer sur les médias et l’activisme des milieux antinucléaires dans une alliance objective pour entretenir un rapport de force favorable avec l’exploitant et l’industrie nucléaire jeté à la vindicte publique, alors qu’il n’y a pas de contrepoids institutionnel à son pouvoir.
Dominique Finon