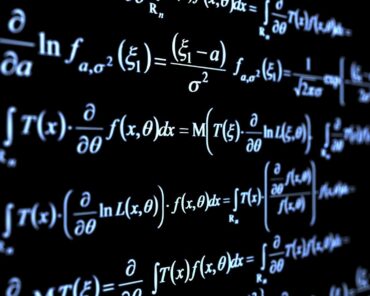Il existe une formule standardisée, généralisée et malheureusement trompeuse pour évaluer le coût réel de l’électricité produite. C’est celle du « LCOE », acronyme de « Levelized Cost Of Energy », en français « coût actualisé de l’énergie ». Elle consiste pour un équipement à faire la somme des coûts actualisés de production divisée par la quantité d’énergie produite, elle aussi actualisée. Tout ce qu’il y a de logique.
En additionnant le coût des investissements (CAPEX) et les coûts d’exploitation (OPEX) d’un projet de production d’électricité, en les actualisant et en les normalisant, on peut obtenir le prix de l’électricité nécessaire pour que le projet soit rentable pendant sa durée de vie et comparer ainsi le prix des sources d’énergie. Mais cet indicateur utilisé abondamment par les institutions et les ONG pour promouvoir les renouvelables intermittents est problématique.
Prendre en compte les coûts supplémentaires
Les calculs du LCOE partent généralement du principe qu’une centrale fonctionnera pendant une période de vingt à trente ans. Il s’agit d’une hypothèse raisonnable pour des technologies comme l’éolien et le solaire. Mais les centrales nucléaires et hydrauliques peuvent fonctionner de manière fiable pendant bien plus longtemps, soixante voire quatre-vingts ans pour le nucléaire et un siècle pour les barrages. En outre, le LCOE ne tient pas compte du coût des terrains nécessaires à la production d’énergie, et il varie considérablement. A production équivalente, les panneaux solaires et les parcs éoliens nécessitent beaucoup plus de surface au sol.
Mais la principale faiblesse du LCOE réside dans son incapacité à prendre en compte les coûts supplémentaires que le système électrique devra supporter selon le type de centrales. Compte tenu du caractère intermittent et aléatoire de la production de renouvelables comme l’éolien et le solaire, il devrait être évident qu’un mégawattheure provenant d’une source renouvelable intermittente ne peut pas être utilisé de la même façon qu’un mégawattheure provenant d’une source dite pilotable, utilisable à la demande (centrales thermiques, nucléaires, hydrauliques…). On compare ainsi avec la formule LCOE des pommes et des poires.
Pour bien mesurer les coûts des différentes productions d’électricité, il faut prendre en compte l’ensemble des coûts du système électrique, et pas seulement ceux de chaque unité de production. On peut ainsi définir un « LCOE du système » qui inclut ces coûts. Ce que les partisans dogmatiques des renouvelables intermittents se gardent bien de faire.
Dans les faits, une électricité toujours plus chère
Et pourtant cela explique pourquoi en dépit de la baisse sensible au cours des dernières années des coûts de production des renouvelables intermittents, surtout solaire, c’est dans les pays où éoliennes et panneaux photovoltaïques représentent une grande partie de la production que les tarifs de l’électricité sont les plus élevés. Il y a des exceptions, comme l’Espagne, avec les conséquences que l’on a vu lors du blackout du 28 avril dernier, faute d’avoir investi suffisamment dans le réseau électrique…
Avec les renouvelables intermittents, il faut impérativement ajouter au coût de construction des équipements ceux nécessaires pour assurer l’équilibre et la sécurité permanentes du réseau de transport de l’électricité produite par une multitude de petites unités (relativement aux grandes centrales centralisées) éparses et émiettées sur les territoires. C’est un problème complexe car en raison des faibles coûts marginaux de l’éolien et du solaire, les centrales électriques pilotables peuvent être et sont évincées du marché. Mais le système électrique ne peut pas s’en passer quand il n’y a pas de vent et de soleil.
La disparition de l’inertie des grandes turbines pour stabiliser les réseaux
Il y a aussi un autre problème, lui aussi mis en évidence par le blackout espagnol, qui tient à la nature de l’électricité produite par les renouvelables d’un côté et les grandes centrales de l’autre. L’éolien et le solaire ne fournissent pas une inertie suffisante au réseau électrique. Ils ne disposent pas de masses rotatives importantes capables d’absorber et de restituer de l’énergie lorsque des fluctuations entre la demande et la production se produisent. Il existe des méthodes pour remédier en partie à cela en utilisant des batteries et des condensateurs afin de fournir une inertie synthétique, mais cela a un coût élevé pour le système électrique et des limites techniques.
Enfin, lorsque l’éolien et le solaire produisent des quantités importantes d’électricité en bénéficiant d’une météorologie favorable, le réseau électrique doit trouver un moyen de consommer cette énergie. Si la demande n’est pas suffisante, il faut alors compter sur le réseau de transport à haute tension et les interconnexions entre pays ou disposer de capacités de stockage (STEP (Stations de transfert d’énergie par pompage), de batteries…). Mais là encore, cela a un coût très élevé.
La gangrène de la surproduction et des prix négatifs
Et puis il y a l’effet de cannibalisation qui se traduit de plus en plus fréquemment sur les marchés européens de l’électricité quand les renouvelables intermittents produisent beaucoup par un effondrement des cours et des prix négatifs. Cela revient évidemment à exclure toute production pilotable du marché mais aussi à réduire considérablement la rentabilité des équipements renouvelables et donc comme ils bénéficient de prix garantis par l’Etat à mobiliser des subventions toujours plus importantes et à accélérer l’envolée des tarifs de l’électricité pour les particuliers et les entreprises.
Aujourd’hui, l’inefficacité du LCOE et les coûts supplémentaires qu’il cache liés aux renouvelables intermittents sont absorbés facialement par les distributeurs et passés directement aux clients via l’augmentation continue des prix de l’électricité. Les opérateurs en profitent et les consommateurs s’appauvrissent…
Même l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui est pourtant un partisan inconditionnel des renouvelables intermittents, le reconnaissait implicitement dans une étude de 2019 sur la croissance de l’énergie solaire. Elle comparait le LCOE et une autre formule un « LCOE ajusté en fonction de la valeur (VALCOE) » entre les centrales solaires et les centrales à charbon. Elle montrait que le solaire était très clairement gagnant et qu’il le serait de plus en plus dans les années suivantes par rapport au charbon en termes de LCOE. Ce qui est une bonne chose. Mais ce n’était plus du tout le cas, si on prenait en compte le VALCOE…