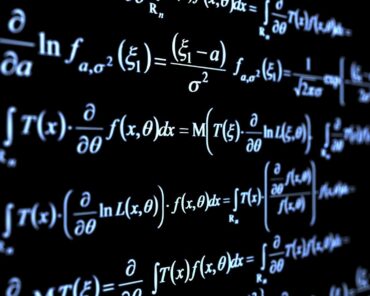Les technologies de capture et de stockage du carbone par l’industrie lourde (CCUS dans le jargon technico énergétique) sont devenues un sujet inépuisable de controverses. Elles font l’objet de deux types de critiques de nature différentes. La première, idéologique, consiste à considérer que si les industriels capturent le CO2 lors de leurs processus de production, ils ne font pas les efforts nécessaires pour décarboner. Mais ce qui importe, c’est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le reste, c’est l’anticapitalisme d’opérette qui pollue l’écologie depuis des décennies. La seconde critique, plus sérieuse cette fois, revient à s’interroger sur l’efficacité réelle des procédés de CCUS. Et les doutes existent.
Mais balayer le CCUS d’un revers de main en y voyant seulement un fantasme de l’ère fossile voué à l’échec masque la réalité. Car pendant les controverses, les projets se multiplient. Et si on s’attarde un peu, on découvre une histoire inattendue : des avancées technologiques, un intérêt croissant de la part des gros émetteurs industriels et des équipements qui se construisent dans des secteurs où les options de décarbonation sont très limitées.
Plus de 350 projets en cours de développement
Il existe aujourd’hui 41 installations de capture et stockage de carbone à l’échelle commerciale en service dans le monde et plus de 350 projets sont en cours de développement. Cela signifie que la capacité installée de capture du CO2, certes modeste, pourrait tout de même doubler en quelques années.
Maintenant, le CCUS n’est pas une panacée. Ce n’est pas une solution miracle, mais cela devient une possibilité bien réelle de décarboner qu’il serait stupide de ne pas utiliser. La capture mondiale actuelle représente entre 40 à 50 millions de tonnes par an à comparer aux 40 milliards de tonnes d’émissions annuelles de CO2. Même à grande échelle et dans quelques décennies, cette technologie contribuera au mieux à 10%, voire 20% dans les rêves les plus fous, à la diminution totale des émissions. Mais sans capture du CO2, les objectifs de décarbonation des prochaines décennies n’ont aucune chance d’être atteints. C’est en tout cas ce qu’affirment aussi bien l’Agence internationale de l’énergie que le GIEC, le World Economic Forum, l’Académie américaine des technologies ou l’Imperial College de Londres.
Il s’agit d’une pièce du puzzle, mais elle est aujourd’hui indispensable. Pour des industries telles que le ciment, l’acier, l’ammoniac et le raffinage, il n’y a pas vraiment d’autres solutions réalistes et relativement rapides à mettre en œuvre pour réduire leurs émissions à grande échelle. C’est le cas aussi pour l’industrie chimique qui représente 5 à 6% des émissions mondiales de CO2, autant que les transports maritime et aérien combinés dont on parle beaucoup plus…
L’embryon d’un écosystème
Plus de 80 entreprises proposent désormais des technologies CCUS et plus de 160 solutions distinctes couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, de la capture au transport, au stockage et à l’utilisation éventuelle du carbone pour fabriquer des matériaux. Ces technologies ne sont plus l’apanage des grandes compagnies pétrolières ou des producteurs de charbon qui ont trouvé un moyen de faire du greenwashing. Un embryon écosystème commence à apparaître avec des projets qui ne sont pas fantaisistes.
En Norvège, Heidelberg Materials a ouvert une unité de capture du carbone unique en son genre dans sa cimenterie de Brevik, capable de piéger 400.000 tonnes de CO2 par an. Ce carbone est liquéfié et transporté par des navires spécialement conçus vers le terminal de stockage Northern Lights, une joint-venture entre Shell, Equinor et TotalEnergies. Une extension est déjà prévue pour porter la capacité de stockage à cinq millions de tonnes par an.
Au Royaume-Uni, plusieurs milliards de livres sont investis dans le CCUS à HyNet (Merseyside) et sur la côte est (Teesside/Humber), soutenus par des subventions gouvernementales afin de capturer 20 à 30 millions de tonnes d’émissions industrielles d’ici 2030. Au Benelux, un consortium regroupant la Belgique et les Pays-Bas prépare le programme Carbon Connect Delta afin de capturer 6,5 millions de tonnes par an d’ici 2030 en reliant des émetteurs industriels à des pipelines de transport et de stockage communs sous la mer du Nord.
Avancées technologiques rapides
Du côté technologique, les avancées sont réelles comme avec les membranes polymères Sepuran d’Evonik, qui connaissent un développement rapide pour traiter la séparation du CO2 issu du biogaz et des gaz de combustion industriels. Elles permettent une capture efficace à moindre coût énergétique. Parallèlement, Nuada de MOF Technologies teste des unités de capture modulaires utilisant des structures métallo-organiques pour piéger le CO2 des cimenteries offrant une efficacité nettement supérieure à celle des systèmes traditionnels à solvants aminés.
Le stockage nécessite lui une modélisation très précise et fiable des réservoirs souterrains. Il existe maintenant des outils de simulation de réservoirs qui utilisent des réseaux neuronaux permettant de prévoir le comportement des panaches de CO2 des milliers de fois plus rapidement que les méthodes conventionnelles. Une avancée essentielle pour la gestion de la pression en temps réel et la sécurité du stockage qui réduit les incertitudes et accélère les délais des projets. CCSNet a développé une plateforme d’apprentissage automatique qui simule la dynamique d’injection de CO2 et fournit des prévisions de pression et de saturation bien plus rapides que les méthodes traditionnelles.
Gouvernements et investisseurs privés s’impliquent progressivement. Les subventions, les crédits d’impôt, les partenariats public-privé se multiplient dans les régions à forte concentration industrielle et à la géologie favorable au stockage, comme la mer du Nord, l’Alberta au Canada et les pôles chimiques alimentés au charbon en Chine et au Benelux.