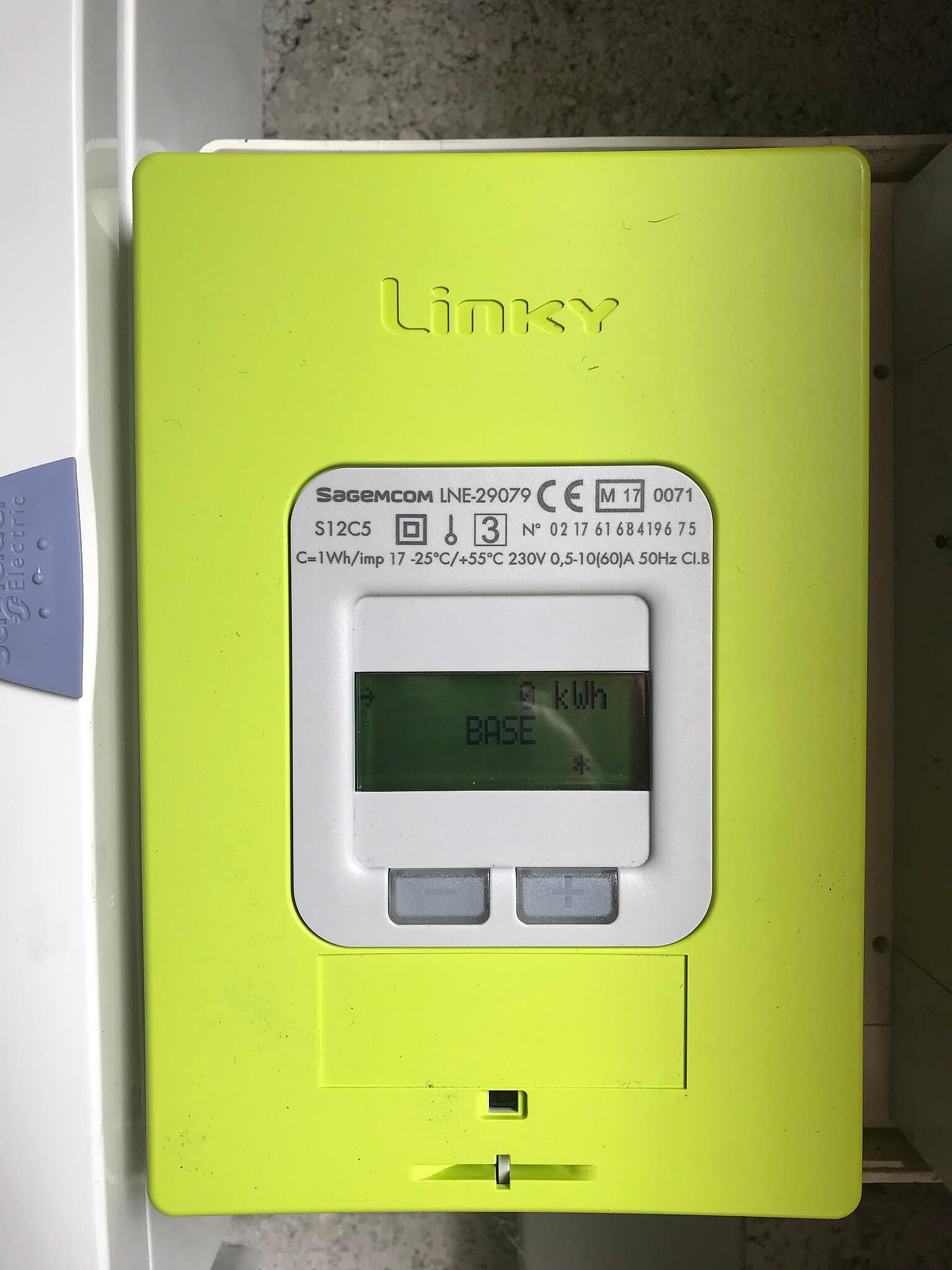Produire de l’électricité bas carbone, c’est bien. Etre capable de la produire quand la demande existe, et de l’acheminer à l’endroit où elle est utile pour être consommée, le tout en conservant en permanence un équilibre production/consommation permettant de maintenir la fréquence à 50 hertz (soit 50 changements de polarité par seconde sur un réseau en courant alternatif), c’est mieux. C’est même indispensable. Et c’est là où le bât blesse dans la stratégie tout renouvelable prônée par les institutions européennes et poursuivie par plusieurs pays européens… dont l’Espagne. Une réalité que les partisans dogmatiques des renouvelables et les lobbys associés ont longtemps niée ou passée sous silence. Le problème est particulièrement criant avec le solaire photovoltaïque qui est en quelque sorte du tout ou rien. Soit il produit massivement profitant d’un ensoleillement important, soit il ne produit rien. Dans les deux cas, les réseaux doivent être capables de s’adapter presque instantanément.
Il convient de rester prudent et il s’agit aujourd’hui seulement d’une hypothèse, mais elle semble de loin la plus plausible. Elle est privilégiée par les opérateurs des systèmes électriques et la Commission européenne : une brusque inadéquation entre l’offre et la demande résultant d’une surproduction ponctuelle d’électricité renouvelable que le réseau haute tension espagnol n’a pas été capable de gérer. En Espagne même, les langues commencent à se délier. Dans Equinox magazine, Eduardo Prieto, directeur des opérations de Red Electrica, le réseau électrique espagnol, explique que « le fait que les déconnexions se soient produites dans la région sud-ouest de la péninsule laisse penser que la perte de production est d’origine solaire ».
Une mise en garde le 18 avril sur le risque de surproduction solaire
L’organisme regroupant les gestionnaires européens de réseaux de transport d’électricité, ENTSOE, avait averti le 18 avril dernier des risques de surproduction solaire à l’approche des beaux jours… Déjà en 2022, il avait publié un rapport de 63 pages en forme de mise en garde. Un document très technique et même obscur qui soulignait que les centrales traditionnelles (fossiles, nucléaire, hydraulique) « ont traditionnellement fourni diverses capacités “inhérentes” au système, essentielles pour assurer le fonctionnement stable des systèmes électriques… » et que les capacités éolienne et solaire sont « dépourvues de ces capacités de système ».
Cela fait plusieurs années en fait que les études se multiplient, émanant aussi bien de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) que de la Commission européenne, attirant l’attention sur la fragilisation des réseaux électriques liée à la part grandissante des renouvelables intermittents dans la production. Leurs fluctuations de production impossibles à prévoir et difficiles à gérer malmènent les réseaux quand il y a sous production, faute de vent et de soleil, et au contraire surproduction quand la météorologie est favorable. Dans ce dernier cas, le risque est que les délestages et transferts sur des réseaux étrangers du surplus d’électricité se fassent mal… Ce qui pourrait bien s’être passé en Espagne au beau milieu d’une journée, le lundi 28 avril, marquée par une consommation pas particulièrement élevée et un ensoleillement important et donc une production solaire importante, notamment avec les nouvelles capacités récemment installées dans le pays.
Le choix espagnol du tout renouvelable à marches forcées
À 12 h 33, au moment de la panne, la production espagnole d’électricité était de l’ordre de 28 gigawatts, dont 60% générés par le photovoltaïque, selon les données compilées par Electricity Maps. Une surproduction mal gérée et une fréquence du réseau devenue erratique a pu provoquer la mise en sécurité dans une réaction en chaîne de presque toutes les installations de production ainsi que des transformateurs et relais. Pour les redémarrer, il a fallu près de 24 heures.
D’autant plus que l’Espagne a fait le choix du tout renouvelable à marches forcées, sans avoir suffisamment adapté son réseau aux nouvelles contraintes en résultant. Entre 2022 et 2024, la capacité de production éolienne du pays est passée de 22 gigawatts à près de 32 gigawatts et celle du solaire photovoltaïque de 17 à 35 gigawatts. Et la péninsule a des interconnexions limitées avec le reste de l’Europe. Elle peut exporter environ 3.000 mégawatts vers la France, autant vers le Portugal, et 1.400 mégawatts vers le Maroc. Que faire, si les voisins n’ont pas besoin de surplus d’électricité ?
Un avertissement
Car les causes plus « classiques » d’un Blackout ne sont manifestement pas là. Il n’y a pas eu de tempête, de tremblement de terre, de feu de forêt. Il n’y a pas eu non plus de chaleurs extrêmes dans la péninsule ibérique. Le mois d’avril n’est pas juillet ou août. La demande d’électricité n’était pas particulièrement élevée comme en hiver lors des périodes les plus froides. Et le scénario d’une cyberattaque massive et coordonnée a été rapidement écarté tout comme celui des éruptions solaires…
Juste après la panne générale, le gestionnaire du réseau électrique portugais (REN) s’est bien hasardé à avancer l’hypothèse d’une défaillance liée à « des variations extrêmes de températures à l’intérieur de l’Espagne qui ont provoqué des oscillations anormales dans les lignes à très haute tension… ». Une thèse loufoque qui selon REN lui a été « faussement attribuée ».
Des centaines de milliards d’investissements nécessaires
Pour le cabinet spécialisé Rystad Energy, le Blackout du 28 avril doit servir d’ultime avertissement. « Sans résilience plus grande au niveau national et sans une meilleure coordination régionale, les futures pannes de réseau pourraient avoir des conséquences encore plus graves… Sans mesure de flexibilité suffisantes, telles que le stockage, les centrales à démarrage rapide ou des interconnexions solides, les fortes variations de la production d’énergie renouvelable peuvent déstabiliser les réseaux… ».
Le problème tient à l’ampleur des investissements nécessaires pour permettre aux réseaux électriques européens de faire face à la fois à l’augmentation de la consommation attendue et plus encore donc de s’adapter au développement des renouvelables intermittents. Ils se chiffrent en centaines de milliards d’euros, très exactement 584 milliards d’euros (entre 2024 et 2030) selon la Commission européenne…