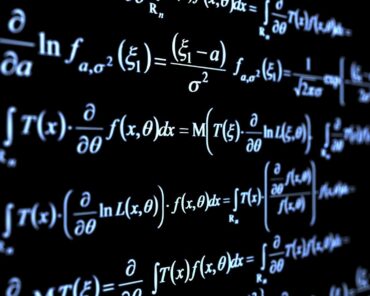Depuis la naissance de la métallurgie, l’humain extrait du sous-sol les ressources dont il a besoin. Ces activités minières se heurtent aujourd’hui à des injonctions paradoxales :
- D’un côté, les sciences de la Terre et du climat nous enseignent la finitude des ressources naturelles – les conséquences délétères de leur utilisation sur notre environnement.
- Mais pour répondre aux objectifs d’énergies renouvelables ou de l’électromobilité, l’utilisation de certains métaux et de terres rares devient incontournable.
- Dans le même temps, les conflits géopolitiques, les crises sanitaires et les tensions commerciales d’aujourd’hui révèlent crûment notre dépendance à ces ressources du sous-sol.
Dans ce contexte, la question de la réouverture de mines en France et en Europe se pose. Ainsi, le Critical Raw Material (CRM) Act européen impose aux États membres de l’Union européenne d’extraire au minimum 10 % de leurs besoins de minerais sur le territoire (et d’en raffiner 40 %). En France, la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol (PRUSS) a fait l’enjeu d’une consultation publique dans le cadre de la loi Climat et résilience.
Ce retour du sous-sol dans les débats nationaux impose de rappeler l’importance de la géologie au cœur même de nos sociétés.
La géologie, au cœur de nos sociétés
En effet, accroître la souveraineté européenne impose de relocaliser en partie l’exploitation du sous-sol, tout en garantissant une gestion la plus durable possible. Ces questions ne sont pas seulement économiques et politiques, mais en premier lieu géologiques.
La géologie moderne est née en Europe et en Amérique du Nordparce que le développement des sociétés des XVIIIe et XIXe siècles demandait de comprendre la nature et l’agencement des différentes roches dans le sous-sol pour les prospecter et en extraire les ressources.
Grand pays charbonnier, la France a exploité de nombreux gisements métalliques, qui ont à la fois fait la richesse des régions concernées et laissé des pollutions chimiques ou géotechniques sur le long terme.
Le sous-sol, premier fournisseur de ressources pour tous nos usages
Les roches, minéraux et métaux fournis par les carrières et par les mines sont à la base de tout ce que nous fabriquons et utilisons au cours de notre vie.
À commencer par l’énergie que nous utilisons, qui reste en majeure partie issue de l’exploitation du sous-sol. Plus de 60 % du mix énergétique français provient encore des énergies fossiles et plus de 80 % de l’électricité est d’origine nucléaire – et donc produite à partir d’uranium. Ces ressources sont presque entièrement importées.
Les énergies renouvelables éoliennes et solaires consomment elles aussi des ressources. Il y a, d’abord, les besoins en ciment pour les éoliennes, consommateur de grandes quantités de calcaire ou de marne (type de calcaire argileux) et de granulats, et dont la production est énergivore et émettrice de dioxyde de CO2. La construction des panneaux solaires et des éoliennes nécessite également du fer, du cuivre, de la silice et des terres rares, sans parler du carburant nécessaire aux engins pour les construire puis pour en assurer la maintenance.
Sans ressources du sous-sol, nous n’aurions ni routes, ni véhicules, ni hôpitaux, pas d’agriculture, pas d’écoles, pas de maisons, pas d’eau au robinet, pas d’électricité ni de chaleur et, bien sûr, pas d’ordinateurs ni de téléphones portables. Le numérique, le télétravail, le streaming et l’IA générative rendent cette question encore plus prégnante.
Bien entendu, le recyclage doit être privilégié, en commençant par la valorisation des déchets des mines, des carrières anciennes et des déchets électroniques et par la réhabilitation des zones minières. Mais cela ne suffira pas à répondre à nos besoins.
De nouvelles ressources et nouveaux gisements à découvrir
Reste que la richesse d’un territoire en métaux et matériaux utiles dépend essentiellement de son histoire géologique. La plupart des gisements se forment à grande profondeur, là où règnent des conditions de pression et de température élevées et où circulent des fluides chauds. Ils sont ensuite ramenés à la surface par l’érosion ou par la tectonique des plaques.
Le cœur ancien des continents, Afrique, Canada, Russie, Australie, ou encore la Cordillère des Andes – tectoniquement active – en est riche. En Europe occidentale, ces conditions géologiques ne sont remplies que sur de plus petites surfaces.
Par exemple, la France possède a priori des réserves de cuivre de plus faibles dimensions, mais des réserves importantes de tungstène, d’antimoine, d’or, de lithium ou de germanium.
Cependant, notre connaissance des mécanismes géologiques menant à la concentration des métaux a beaucoup progressé au cours des dernières décennies. Il est probable que de nouveaux gisements puissent être découverts, si l’on se donne la peine de les chercher. Le programme PEPR Sous-Sol Bien Commun et le nouvel inventaire des ressources minérales de la France lancé par le BRGM vont dans ce sens.
En ce qui concerne les ressources énergétiques du sous-sol, le potentiel géothermique de la France devrait lui aussi être revu à la suite des progrès dans la compréhension de la structure thermique de la Terre et de la circulation de l’eau en profondeur. Le principal intérêt de la géothermie est qu’il s’agit d’une source d’énergie inépuisable.
Il existe déjà en France un fort potentiel de géothermie appelée « géothermie de minime importance » (GMI, appelée de la sorte, car il s’agit de géothermie à très basse température) de l’ordre de 100 térawattheures (TWh)/an, soit la production annuelle de 10 centrales nucléaires. Son développement pourrait créer des dizaines de milliers d’emplois non délocalisables.
Au-delà de la prospection de nouvelles ressources minières, nous devons donc développer plus activement la géothermie sur l’ensemble du territoire national, et cela sous toutes ses facettes : basse, moyenne et haute température. Pour cela, une montée en compétences sur toute la chaîne de valeur, de la compréhension géologique aux techniques de géothermie, est indispensable.
Un débat qui impose de mieux former citoyens et décideurs
L’exploitation du sous-sol et la transformation des minerais en usine soulèvent des enjeux économiques, environnementaux et sociaux majeurs. Nous ne pouvons plus faire l’autruche en utilisant à profusion des ressources extraites dans des pays tiers sans nous soucier de notre dépendance et des conséquences environnementales et sociales là où les législations ne sont pas aussi strictes qu’en Europe.
Ces questions, qui appellent à des arbitrages complexes, demandent des débats sereins, qui ne pourront avoir lieu que si nous avons tous accès à un socle minimal de connaissances, tant géologiques qu’environnementales. Il y a donc urgence à mieux former nos concitoyens et nos dirigeants, d’abord à l’école, puis tout au long de la vie.
Pourtant, les sciences de la Terre trouvent à l’heure actuelle de moins en moins leur place au collège et au lycée. Étudier la géologie est pourtant crucial pour comprendre la formation des montagnes et des océans, les mécanismes des volcans et des séismes ou, encore, pour comprendre comment la tectonique des plaques a orienté l’évolution du vivant. Autant de sujets passionnants qui sont à même de motiver nos jeunes concitoyens.
Investir dans la recherche, un choix stratégique
Investir dans la recherche en sciences de la Terre est tout aussi essentiel.
Les dépenses de la France en recherche fondamentale aujourd’hui restent très insuffisantes au vu des enjeux actuels. La France, malgré un niveau élevé de dépenses publiques, consacre seulement 0,3 % de son PIB à la recherche fondamentale, soit deux fois moins que la moyenne européenne.
C’est pourtant grâce à la recherche, fondamentale comme appliquée, que l’on pourra concevoir des solutions durables pour économiser les ressources naturelles, développer l’écoconception, diminuer les empreintes de nos activités (eau, sol, métaux, matériaux, énergie, climat…).
Mieux comprendre les processus géologiques et biologiques en jeu aidera à développer des alternatives non carbonées aux énergies fossiles : par exemple, la géothermie, la récupération de chaleur industrielle, l’hydrogène natif, les carburants de synthèse et les biocarburants.
Mais avant de se prononcer pour ou contre l’exploitation des ressources de notre sous-sol (métaux, roches, minéraux, énergies), il est essentiel de s’interroger sur nos modes de consommation et sur ce dont nous avons réellement besoin. Dans ce contexte, alors que l’Union européenne cherche à mieux encadrer et à valoriser les métaux, un débat national s’impose. La Société géologique de France, que je représente à travers ce texte, est prête à y participer activement.
Laurent Jolivet Professeur, Sorbonne Université.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.
Laurent Jolivet est président de la Société géologique de France. Les membres du conseil d’administration de la Société géologique de France ont également participé à l’écriture de cet article.