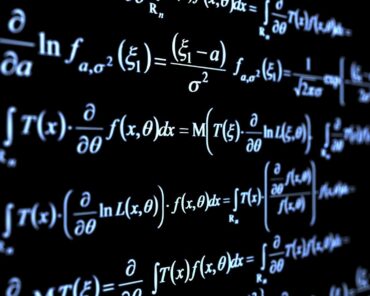Dans le temps qu’il aura fallu pour lire cette phrase, l’industrie mondiale du BTP aura coulé plus de 19 000 baignoires de béton. Lorsque la moitié de cet article sera lu, le volume remplira l’opéra de Paris. En un jour, il sera presque aussi grand que le barrage des Trois Gorges en Chine, le plus grand du monde. Il a fallu dix-sept ans à 40 000 personnes pour le construire ainsi que 28 millions de mètres cubes de béton et suffisamment d’acier pour construire 63 copies identiques de la tour Eiffel. En une année, il se produit assez de béton sur terre pour recouvrir chaque colline, chaque vallon, chaque centimètre carré de la France métropolitaine.
L’industrie qui permet sa fabrication, celle qui produit du ciment, est à la fois la plus sale et la plus indispensable. Il est difficile de mesurer spontanément l’importance du ciment. Et pourtant, il s’agit de la deuxième matière la plus utilisée par l’humanité derrière… l’eau. Le ciment est un élément essentiel du monde moderne. Il est le liant qui permet de fabriquer le béton, matériau omniprésent et indispensable à la construction, au bâtiment comme aux travaux publics, dans les pays riches comme dans les pays en développement. Il fournit des toits à des milliards de personnes, renforce nos défenses contre les éléments naturels et fournit les structures pour la santé, l’éducation, les transports, l’énergie et l’industrie. Le béton permet aux hommes d’essayer de dompter la nature.
4,6 milliards de tonnes produites chaque année
Pour faire du béton, il se fabrique chaque année la quantité astronomique de 4,6 milliards de tonnes de ciment et sa production seule représente 8 % des émissions mondiales annuelles de CO2 (4 % dans l’Union européenne). Seules les énergies fossiles émettent plus de gaz à effet de serre. Si le ciment était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine et les États-Unis. Les deux tiers de ces émissions proviennent de la réaction chimique inhérente au processus de fabrication du ciment. Chaque tonne de ciment ordinaire dit Portland (voir encadré) produit se traduit par l’émission dans l’atmosphère de 0,6 à 0,9 tonne de CO2.
Il est tout simplement impossible de s’en passer. Même l’Europe où les besoins de construction et de nouvelles infrastructures n’ont rien de comparables avec ceux des pays en développement consomme 170 millions de tonnes de ciment par an. Cela se traduit par 325 kg de ciment par personne et par an. L’équivalent en poids, toujours par personne, de cinq mois d’alimentation. Et ses 325 kg de ciment permettent de fabriquer 2 tonnes de béton par personne et par an.
Ne pas déstabiliser l’écosystème de la construction
Cela signifie une chose : il est impératif pour réussir la transition énergétique de parvenir à fabriquer en très grandes quantités et à des coûts acceptables du ciment bas-carbone. C’est un défi difficile à relever pour des raisons aussi bien économiques que techniques. Même si la filière croit fermement qu’elle peut relever un défi sans précédent dans l’histoire industrielle (lire page 58).
L’échelle des transformations à effectuer est colossale tout comme les niveaux d’investissement nécessaires pour transformer les usines et en construire de nouvelles. Et cela nécessite des aides gouvernementales massives, économiques et réglementaires. Cela va conduire à des recompositions industrielles et financières et à un changement des méthodes de travail de toute la filière du bâtiment et des travaux publics. Certains bétons décarbonés sont plus fluides et requièrent des changements de comportement des ouvriers lors des coffrages ou du coulage du béton afin d’assurer aussi bien l’étanchéité du matériau que leur propre sécurité. Et il faut faire cela sans déstabiliser l’écosystème de la construction. Seulement en France, il représente près d’un demi-million de personnes, de l’architecte au maçon, en passant par les cimentiers, ingénieurs de bureaux d’étude, industriels du préfabriqué et constructeurs.
Plusieurs stratégies mises en œuvre en parallèle
Le défi est d’autant plus difficile à relever qu’il faut dans le même temps réduire rapidement les émissions de CO2 tout en répondant à la demande mondiale. Plusieurs stratégies sont mises en œuvre en parallèle pour y parvenir.
Il faut réduire la consommation d’énergie et surtout remplacer les fossiles par des sources d’énergie bas-carbone pour faire fonctionner les fours qui permettent de fabriquer la fine poudre grise. Il faut modifier et adapter les formules pour pouvoir utiliser des matériaux différents et des produits réduisant leurs émissions tout en ne perdant pas les qualités de solidité et de liant. Il faut capturer et stocker le CO2.
Toutes ces techniques sont indispensables, car les émissions de gaz à effet de serre provenant de la fabrication du ciment se décomposent schématiquement en deux parties. Environ un tiers résulte de l’énergie utilisée pour porter dans des fours les matériaux à 1 500 oC et provoquer la réaction chimique qui permet de produire le ciment. Il y a ensuite la réaction chimique en elle-même, les deux tiers des émissions, qui détache le CO2 des matériaux réduits en fine poudre grise. Il n’existe pas, en l’état actuel de la recherche et des connaissances, une méthode de substitution pour fabriquer du ciment à grande échelle. Cela signifie qu’il n’y a pas d’autre possibilité que de capter le CO2 à la sortie du four et le stocker pour qu’il ne se répande pas dans l’atmosphère.
La capture du CO2 passe au stade industriel
La technologie utilisée est celle que les spécialistes de la capture du carbone appellent le CCS ou Carbon Capture and Storage. La capture du CO2 recouvre deux procédés de nature très différente, à savoir la capture et le stockage lors de processus industriels (CCS) et la capture dite directe dans l’atmosphère (DAC ou Direct Air Capture).
Il n’est question ici que de CCS qui, comme son nom l’indique, consiste à capter dans les usines le carbone émis par la combustion des énergies fossiles et par les procédés industriels avant qu’il ne se répande dans l’atmosphère. Il existe une variante du CCS dite CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) qui consiste à utiliser pour la fabrication de matériaux tout ou partie du carbone capturé lors d’autres processus industriels. Mais elle concerne assez peu la décarbonation des cimenteries.
L’avancée majeure est que la capture du CO2 passe aujourd’hui véritablement au stade industriel. Il y a quelques mois, le cimentier Heidelberg Materials a signé un accord avec le gouvernement canadien pour la construction d’une unité de 1 milliard de dollars destinée à capturer 1 million de tonnes de carbone par an dans son usine d’Edmonton, ce qui représente 95 % des émissions totales. L’usine canadienne stockera ses émissions sous terre. En tout, Heidelberg a aujourd’hui neuf projets de capture et stockage du carbone dans le monde en Amérique du Nord et en Europe.
Les deux premiers à être opérationnels seront donc à Edmonton et à Brevik en Norvège dans les tous prochains mois (lire page 55). Heidelberg n’est pas le seul. Lafarge et Vicat, par exemple, ont aussi des projets pilotes. En France, la cimenterie de Montalieu-Vercieu de Vicat en Isère, la plus importante du pays et l’une des plus modernes, doit commencer à capturer et à stocker du CO2 à partir de 2027.
Air Liquide a obtenu de son côté des financements de l’Union européenne pour deux projets de capture : Go4ECOPLANET qui vise à décarboner entièrement la production de ciment dans une usine Lafarge à Kujawy (Pologne) et K6 qui a pour ambition de produire le premier ciment neutre en carbone en Europe à Lumbres (Hauts-de-France). Ensemble, ces deux projets, qui devraient entrer en service entre fin 2027 et début 2028, devraient permettre de capter 18 millions de tonnes de CO2 sur une dizaine d’années.
Un problème avant tout économique et financier
En dehors de la capture du CO2, les experts de l’industrie et les chercheurs travaillent depuis deux décennies sur les moyens d’utiliser moins de clinker (le constituant de base du ciment, voir encadré), et bien qu’ils puissent réduire la quantité nécessaire en le mélangeant à d’autres produits, il n’y a actuellement pas de ciment sans au moins une certaine quantité de clinker. Les nouveaux ciments bas-carbone permettent d’émettre moins de 400 kg de CO2 par tonne contre 625 en moyenne pour le ciment classique Portland.
Tout le ciment fabriqué pourra-t-il un jour prochain être à faible teneur en carbone ou « vert » ? La définition de l’expression « à faible teneur en carbone » jouera un rôle très important dans la manière dont elle sera mise en pratique dans l’industrie. Mais la transformation des grandes usines de production de ciment existantes en incorporant les technologies permettant de se passer de combustibles fossiles et de capturer le carbone est tout à fait possible. Il est techniquement faisable de produire efficacement du ciment à faible teneur en carbone à grande échelle. Le problème aujourd’hui est avant tout économique et financier.
Selon le cabinet McKinsey, il faudra investir 60 milliards de dollars par an jusqu’en 2050 pour décarboner l’industrie mondiale du ciment et du béton. C’est une somme considérable, mais cela est possible si la demande est au rendez-vous.
La condition sine qua non de la réussite de la transformation de l’industrie mondiale du ciment est que la demande de produits bas-carbone, forcément plus coûteux et dans un premier temps plus délicat à utiliser, existe et se développe. Pour cela, les pouvoirs publics ont un rôle majeur et doivent imposer ces nouveaux matériaux aux consommateurs. Ce sont eux qui paieront la transition. Après tout, le ciment et le béton ne représentent en moyenne que 10 à 15 % du coût d’une construction, ce qui peut rendre relativement supportable une hausse de prix. Si les gouvernements et le secteur de la construction mettent en place les mesures d’incitation appropriées, la quasi-totalité du ciment produit dans le monde dans vingt-cinq ans pourra être à faible teneur en carbone.