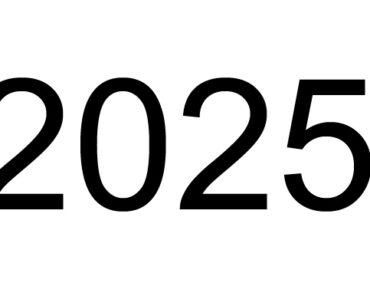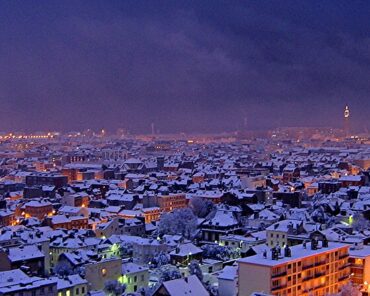La dramatique, pourtant bien rôdée des COP avec des accords obtenus à l’arraché à l’issue de suspenses insoutenables…, est vraiment détraquée. Pour la 30ème édition brésilienne de la Conférence des parties, il n’y a même pas eu d’accord final le 22 novembre sur un texte dont tout le monde aurait pu faire semblant de croire qu’il va dans le bon sens et que l’humanité a fait un « petit pas » en avant. Les COP ne peuvent même plus servir aux institutions internationales, aux multiples ONG présentes et aux dizaines de milliers de délégués qui se retrouvent tous les ans à justifier leur existence avec le soutien actif du battage médiatique.
C’est ce que résumait déjà parfaitement l’an dernier Brice Lalonde à l’issue de la COP29 de Bakou en Azerbaïdjan, « les COP sont devenues des machines à négocier le vide ». Et plus grand monde n’est dupe. Les COP ne sauvent pas le monde. La plupart des observateurs indépendants reconnaissent qu’elles n’ont aucun impact ou presque sur les politiques énergétiques des pays qui comptent réellement en matière d’émissions de gaz à effet de serre, à savoir la Chine, les Etats-Unis, l’Inde, la Russie, l’Arabie Saoudite…
Comme l’explique dans Le Point, Ted Nordhaus, cofondateur du Breakthrough Institute, un influent think tank américain sur l’énergie et l’environnement, « il n’y a pas un seul moment depuis la création de ce processus où ces conférences ont exercé une influence réelle et mesurable sur la trajectoire mondiale des émissions. Depuis le protocole de Kyoto, c’est un rituel diplomatique, sans conséquences pratiques. Les pays viennent, annoncent des engagements, puis ne les respectent pas dès qu’ils deviennent coûteux ou impopulaires ».
La Chine et les Etats-Unis sont parvenus à leurs fins
Ainsi, les deux plus grands émetteurs de carbone au monde, la Chine et les États-Unis, auront eu paradoxalement une influence comparable sur cette COP30… en la rendant encore plus inutile. Mais ils y sont parvenus de façons très différentes. L’administration Trump n’avait envoyé aucune délégation, mais son opposition affirmée à la lutte contre le réchauffement climatique a dopé ses alliés présents. L’Arabie saoudite et d’autres grands pays producteurs de pétrole se sont montrés ouvertement hostiles à toute initiative allant dans le sens d’une réduction de la consommation des énergies fossiles. Et ils ont obtenu le soutien visible et actif de la Russie. La Chine est restée elle discrète et s’est concentrée, sans surprise, sur la défense de ses intérêts économiques à savoir ses exportations, en montant notamment une coalition contre les taxes carbones aux frontières. Comme celle que veut imposer l’Europe…
L’Europe justement, qui rappelons-le, se veut le modèle planétaire de la transition et le moteur politique des COP – la France se glorifie encore sans cesse de l’accord de Paris de 2015 – a subi un véritable camouflet à Belém. Sur les deux points clés qu’elle entendait défendre, une feuille de route, non contraignante, de sortie des énergies fossiles et la lutte contre la déforestation, elle n’a rien obtenu et n’a pas réussi à coaliser suffisamment de pays autour d’elle. Au point que pour ne pas être « isolées », la France et l’Europe se sont tout de même résignées à signer l’accord final. « Nous devons soutenir [cet accord] car il va au moins dans la bonne direction », a déclaré sans rire le commissaire européen au climat, Wopke Hoekstra. Et s’exprimant à peu près au même moment que Wopke Hoekstra lors du G20 en Afrique du Sud, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a été encore plus ridicule en déclarant : « nous ne luttons pas contre les combustibles fossiles, nous luttons contre les émissions provenant des combustibles fossiles ». En forme d’apothéose, Laurence Tubiana, cheville ouvrière de l’accord de Paris en 2015, a expliqué que « le multilatéralisme perdure, nous avons prouvé que Trump avait tort, l’action climatique est inéluctable. A présent, les gouvernements doivent faire mieux et aller au-delà de leurs engagements actuels ».
Commencer par le charbon
Une feuille de route détaillée sur la sortie des énergies fossiles n’aurait évidemment pas eu force de loi. Mais elle aurait mis les pays au pied du mur et surtout l’opinion mondiale face à la réalité. Soit les pays la signait, soit ils admettaient publiquement qu’atteindre les objectifs de l’accord de Paris, signé lors de la COP 21 de 2015, est impossible.
Pour que les COP soient vraiment utiles à quelque chose, il faudrait qu’elles commencent par se donner des objectifs réalistes et ayant un impact tangible sur les émissions. La priorité devrait être ainsi de trouver le chemin pour se passer du combustible fossile qui émet le plus de gaz à effet de serre, le charbon. Il représente 40% de toutes les émissions liées à l’énergie. Et les promesses de renoncement au charbon, faites à la COP26 de Glasgow en 2021 et réitérées lors de la COP28 de 2023 à Dubaï, n’ont jamais été suivies d’effet. L’année 2025 sera marquée par un nouveau record de la consommation mondiale de charbon. Il existe aujourd’hui plus de 6.500 centrales électriques au charbon dans le monde. À la fin de l’année dernière, la capacité totale de production d’électricité à partir de charbon a atteint le niveau sans précédent de 2.175 GW… et pas moins de 611 GW supplémentaires sont dans les tuyaux.
Le texte final de la COP30 ne fait qu’une référence indirecte à la sortie des énergies fossiles, en rappelant à peine le consensus de la COP28. Il n’en reprend même pas les termes. A Dubaï en 2023, il était question « d’opérer une transition juste, ordonnée et équitable vers une sortie des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques ». Cette fois, l’accord final se contente d’inviter à « accélérer » la transition « de façon volontaire ». La Chine, l’Inde, l’Arabie Saoudite, le Nigeria et la Russie ne voulaient pas entendre parler d’une feuille de route sur la sortie des énergies fossiles. Et même si le président brésilien Lula avait promis de faire de la COP30 « la meilleure de toutes », son pays est un producteur important de pétrole et a l’intention de sérieusement augmenter sa production dans les prochaines années.
Les intérêts bien compris du Brésil et de la Chine
L’an dernier, le Brésil s’est classé au huitième rang mondial pour la production de pétrole devant les Emirats arabes unis et derrière l’Iran, avec une moyenne d’un peu plus de 3,5 millions de barils par jour. Le ministère brésilien de l’énergie prévoit que le pays pompera 5,4 millions de barils par jour d’ici 2029. Le Brésil a des réserves très importantes estimées à plus de 35 milliards de barils et pouvant aller, selon certains experts, jusqu’à plus de 60 milliards de barils.
Enfin, la Chine a clairement remporté la seule bataille qui lui importait : créer un « dialogue » sur le commerce mondial. En fait, il s’agit de mener, avec le soutien de plusieurs autres pays dont l’Inde et l’Arabie Saoudite, la fronde contre le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières que l’Union Européenne entend imposer aux importations de certains produits industriels dès janvier 2026. La Chine a obtenu que soit mentionné dans le texte de l’accord final que « les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ni une restriction déguisée au commerce international ».
Mais la prochaine COP31 qui se tiendra en Turquie fin 2026 à Ankara va tout arranger. Le pays hôte l’a promis… Elle fera preuve d’ambition, de transparence et d’inclusivité. Qui peut en douter?