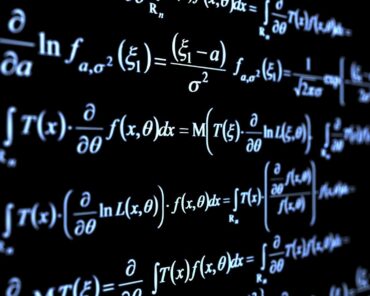Une erreur fondamentale commise souvent par les gouvernements, les institutions et les militants consiste à considérer la transition énergétique comme un impératif moral nécessitant d’indispensables sacrifices. Pour créer une humanité nouvelle vertueuse, il faut renoncer, en partie, au bien-être matériel. C’est-à-dire à une énergie abondante et bon marché. Et comme l’économie, c’est tout simplement de l’énergie transformée, cela signifie un appauvrissement généralisé. Pas étonnant si passé l’enthousiasme initial et en dépit d’une propagande incessante en faveur du « verdissement » de toutes les activités humaines, les populations rejettent la transition, non dans son principe mais dans sa réalité.
Cela signifie que les stratégies politiques, économiques et sociales menées aujourd’hui ne sont pas les bonnes et en plus la plupart du temps assez inefficaces. Il suffit de se pencher sur la fameuse PPE3, Programmation pluriannuelle de l’énergie version 3. En France, dans un pays qui produit bien trop d’électricité par rapport à ses besoins qu’il est contraint d’exporter à prix cassés et une électricité décarbonée à 95%, investir massivement dans les renouvelables intermittents (éolien et solaire) n’a pas beaucoup de sens. Cela revient à renchérir durablement le prix de l’électricité pour le seul et unique bénéfice du lobby renouvelable.
Fixer des priorités technologiques
Pour sortir de cette impasse, il faut être capable de fixer des priorités technologiques et économiques construites à partir des faits et pas de gains politiques supposés, du poids des lobbys ou d’une idéologie voulant détruire le capitalisme. Cela passe notamment par l’innovation et l’investissement dans des technologies capables de réellement changer la donne. Elles existent. L’histoire humaine est marquée par des ruptures technologiques qui ont changé le destin de l’humanité, non sans oppositions souvent farouches. Pour prendre des exemples récents, l’éclairage au gaz, les bateaux à vapeur, les ampoules incandescentes, les téléphones, les moteurs à essence, les avions, le courant alternatif, les fusées, l’énergie nucléaire, les satellites de communication, les ordinateurs individuels… se sont heurtés au conservatisme et aux intérêts économiques installés
Voilà pourquoi trois technologies assez peu connues et pourtant susceptibles de changer la donne méritent qu’on leur accorde plus d’attention.
-Les panneaux solaires avec de la pérovskite
Les panneaux photovoltaïques utilisant de la pérovskite, un minéral plus performant que le silicium, sont le graal de l’électricité solaire. Ils offrent en théorie un rendement bien supérieur aux panneaux classiques pour un coût de fabrication bien plus faible et une facilité d’utilisation bien plus grande. Cela fait une décennie que l’on promet une percée majeure dans la pérovskite, elle semble prendre forme. Cela est d’autant plus important que Le solaire photovoltaïque est la source d’énergie renouvelable qui connait le développement le plus rapide et est devenue, du fait de la surproduction chinoise massive de panneaux, la moins coûteuse. Mais cela n’efface pas pour autant les faiblesses de cette technologie, à savoir l’intermittence, la durée de vie des équipements et surtout un rendement énergétique effectif limité de l’ordre de 20% en moyenne.
La pérovskite promet un rendement supérieur à 25%, ce qui est un progrès considérable, une durée de vie d’au moins 20 ans des panneaux et surtout des coûts de fabrication très réduits (d’environ 50%) et une très grande facilité de production. L’avantage principal du pérovskite est d’être un bien meilleur conducteur d’électricité que le silicium des panneaux classiques. Ce matériau minéral permet des rendements théoriques dépassant les 30%.
Il s’agit d’un minéral composé de calcium, de titane et d’oxygène (titanate de calcium) découvert par un minéralogiste russe, Lev Perovski, en 1839 dans l’Oural et baptisé en son honneur par le minéralogiste allemand Gustav Rose. La pérovskite surgit ainsi l’année même où Edmond Becquerel découvre l’effet photoélectrique… Mais il faudra attendre 2006 pour que le Japonais Tsutomu Miyasaka de l’université Toin révèle que certaines pérovskites ont des propriétés semiconductrices remarquables.
-Les supraconducteurs à température ambiante
La révolution des supraconducteurs est annoncée et espérée depuis plus d’un siècle. Elle pourrait permettre de transformer radicalement la façon de stocker, transporter, utiliser et concentrer l’électricité. Elle pourrait donc avoir un impact considérable sur les réseaux électriques, sur la fusion nucléaire, sur les trains à grande vitesse ou même sur l’efficacité des circuits électroniques. La supraconductivité est caractérisée, comme son nom l’indique, par l’absence de toute résistance électrique. Elle a été découverte en 1911 par le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes mais à des températures extrêmement basses proches du zéro absolu (-273,15°C). Théoriquement, dans des matériaux supraconducteurs, les courants électriques peuvent circuler indéfiniment sans la moindre perte d’énergie. Voilà pourquoi depuis plus d’un siècle des chercheurs tentent de synthétiser des matériaux qui aient des propriétés supraconductrices mais à des températures moins élevées et également dans des conditions de pression permettant leur exploitation industrielle.
C’est ce que des chercheurs de l’Université de Rochester (Etat de New York) sont parvenus à accomplir il y a deux ans selon un article publié dans la revue scientifique Nature. Ils ont créé un matériau supraconducteur ayant cette propriété dans des conditions de températures et de pressions suffisamment basses pour en permettre une utilisation pratique. Les chercheurs décrivent un matériau composé d’hydrure de lutétium (ou lutécium) dopé à l’azote qui présente une supraconductivité à 69° Fahrenheit (20,5 °C) et 10 kilobars de pression.
-Des processus d’électrolyse plus efficace pour produire de l’hydrogène
La principale faiblesse des énergies renouvelables (éolien et solaire) est leur intermittence de production. Elles produisent trop, quand il y a du vent et du soleil, et trop peu quand la météorologie n’est pas favorable. La seule solution est en théorie de stocker l’électricité. Physiquement cela n’est pas vraiment possible. On peut convertir l’électricité mécaniquement, en pompant par exemple de l’eau dans les bassins supérieurs des barrages, et chimiquement via des batteries ou en fabriquant de l’hydrogène par électrolyse de l’eau. Ensuite, on peut reproduire de l’électricité avec les turbines des barrages, les batteries et l’hydrogène.
L’avantage de l’hydrogène est qu’il s’agit d’un carburant qui peut se substituer aux combustibles fossiles dans de nombreux domaines de l’industrie et des transports. On peut aussi utiliser l’hydrogène pour fabriquer assez facilement des carburants synthétiques. Mais produire de l’hydrogène vert par électrolyse est coûteux, notamment parce que l’efficacité énergétique est faible, de l’ordre de 60%. Produire ensuite de l’électricité avec une pile à combustible et l’hydrogène produit ramène l’efficacité énergétique à un maigre 30%.
Rendre plus efficace le processus de l’électrolyse est une nécessité. C’est ce sur quoi travaillent de nombreux chercheurs dans le monde. D’ores et déjà, les technologies alcalines sont peu à peu remplacées par les technologies dites PEM (membrane échangeuse de protons), plus performantes notamment avec les fluctuations de production d’électricité renouvelable intermittente. Mais la technologie PEM est coûteuse et nécessite des métaux rares.
La technologie SOEC, d’électrolyse à oxyde solide, semble plus prometteuse et nécessite de la vapeur mais arrive à maturité. Enfin, il y a la technique à membrane échangeuse d’anions. Elle est flexible et ne nécessite pas l’utilisation de métaux rares. Quand elle sera développée sur le plan industriel, elle sera une alternative à la technologie MEP.