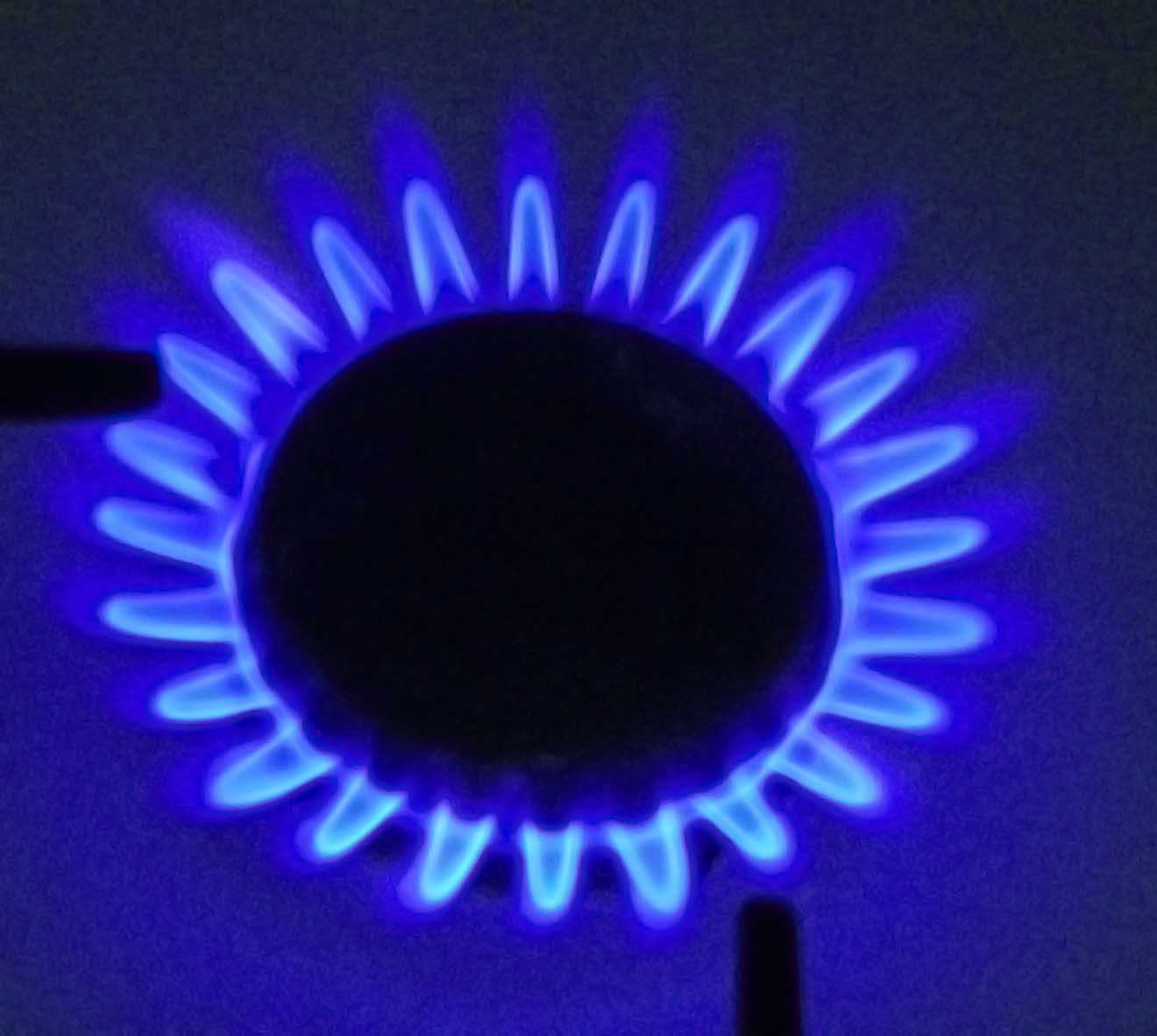Le cartel pétrolier OPEP+ qui regroupe l’OPEP historique comprenant 13 pays producteurs, menés par l’Arabie Saoudite, et leurs 10 pays alliés, menés par la Russie, a décidé une nouvelle fois au début du mois d’août d’augmenter ses quotas de production. Ils progresseront de 548.000 barils par jour en septembre prochain. Cela intervient après trois augmentations consécutives des quotas de 411.000 barils par jour en mai, juin et juillet et une de 548.000 barils par jour en août. Le cartel a totalement changé de stratégie qui consistait depuis 2020 et la guerre des prix entre l’Arabie Saoudite et la Russie au début de la pandémie de Covid à restreindre l’offre pour maintenir les cours à des niveaux élevés.
Une stratégie mise à mal par l’augmentation des capacités de production de pays producteurs qui n’appartiennent pas au cartel et par le manque de discipline au sein même de l’OPEP+. Le cartel est ainsi en train de renoncer et même au-delà à la coupe de 2,2 millions barils par jour mise en place en avril dernier sur la production des pays membres.
Il a fait le choix, surtout l’Arabie Saoudite, des parts de marché plutôt que de tenter de maintenir des tarifs élevés, ce qu’il n’arrive pas à faire. Il faut dire que l’objectif fixé de maintenir le prix du baril à au moins 80 dollars n’a presque jamais été atteint. Les cours du barils se trouvaient le 15 août en début de journée entre 64 et 67 dollars.
Même pendant les douze jours de guerre ouverte en juin entre Israël et la République islamique d’Iran, les cours du baril ont flirté avec les 80 dollars mais ne se sont pas envolés en dépit des menaces de Téhéran de bloquer le détroit d’Ormuz par où transitent les exportations de pétrole de la plupart des pays de l’OPEP historique. Il est vrai que depuis 2020, la part de marché de l’OPEP+ n’a cessé de baisser revenant de plus de 30% tout au long des années 2010 à 27% aujourd’hui.
Un changement majeur par rapport aux crises passées
L’OPEP+ a tout simplement perdu une partie de son pouvoir sur le marché pétrolier. Et les pays producteurs du Moyen-Orient ont perdu une partie de leur influence géopolitique. La diversification énergétique mondiale et la réduction de la dépendance occidentale, en particulier des États-Unis et dans une moindre mesure de l’Union européenne, ont rendu les marchés plus résistants aux guerres et aux conflits de cette région et aux pressions.
En dépit des craintes, les sévères turbulences géopolitiques au Moyen-Orient, depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 et l’escalade entre Israël et la République islamique d’Iran et tous ses affidés régionaux n’ont pas porté de coup sévère aux marchés mondiaux de l’énergie. Comparé aux crises régionales passées ou aux chocs majeurs tels que la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’impact a été étonnamment limité.
Sachant que si l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a eu pour effet de faire s’envoler les cours du gaz, elle a eu un impact limité sur le pétrole. Compte tenu des embargos imposés à la Russie, il y a eu avant tout un changement des flux. Les 5 millions de barils par jours exportés par la Russie sont partis à prix cassés vers la Chine, l’Inde et la Turquie et l’Europe s’est approvisionnée plus fortement au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique. En tout cas, l’incapacité apparente des pays du Moyen-Orient riches en pétrole à utiliser leur puissance pétrolière comme une arme politique a surpris.
Le souvenir du choc pétrolier de 1973
Depuis les années 1970, la richesse pétrolière constituait l’épine dorsale du pouvoir des États du Moyen-Orient, façonnant à la fois leur économie et leur influence politique. En s’appuyant sur leur rôle central au sein de l’OPEP et sur leur capacité à influencer l’équilibre énergétique mondial, ces pays ont acquis un poids considérable sur les affaires internationales, disproportionné avec leur importance économique et démographique.
Alimentés par l’afflux de richesses provenant de leurs gisements d’hydrocarbures, de nombreux dirigeants régionaux ont tenté de moderniser leurs États avec des succès contrastés et surtout consolidés des régimes autoritaires… avec la bienveillance occidentale. Pour la plupart des pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient, les revenus pétroliers et gaziers assurent plus de 70% des recettes des gouvernements et environ un tiers du PIB et même plus pour des pays comme l’Irak et le Koweït.
En fait, jusqu’à aujourd’hui, les conflits au Moyen-Orient ont toujours déclenché des flambées des cours du baril. L’utilisation politique du pétrole avec succès remonte à 1960, lorsque les États pétroliers du Moyen-Orient ont uni leurs forces à celles du Venezuela pour créer l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). La première utilisation majeure du pétrole en tant qu’arme politique a eu lieu pendant la guerre israélo-arabe dite de Kippour de 1973, lorsqu’après l’attaque d’Israël simultanée par l’Egypte et la Syrie les pays arabes ont imposé un embargo pétrolier qui a déclenché une crise énergétique historique, le choc pétrolier, et fait monter en flèche les prix du pétrole. Ils sont passés d’environ 3 dollars à près de 12 dollars le baril en l’espace de cinq mois.
Les chocs de 1979, 1991, 2011, 2019
Le deuxième choc majeur est survenu en 1979 avec la révolution islamique iranienne, qui a réduit les exportations de pétrole iranien et provoqué une nouvelle flambée des prix mondiaux. À peine un an plus tard, la guerre Irak-Iran a éclaté aggravant encore les craintes de perturbations de l’approvisionnement régional et faisant grimper un temps les cours du baril à 40 dollars. Dix ans plus tard, en 1990, l’invasion du Koweït par l’Irak – un autre État riche en pétrole du golfe Persique – a fait passer les prix de 17 à 36 dollars le baril. La première guerre du Golfe a permis de libérer le Koweït.
L’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003 a ouvert une nouvelle ère de volatilité pétrolière. Les cours du baril sont passés de 26-30 dollars au début des années 2000 à 66 dollars en 2006. La crise économique et financière de 2008-2009 a fait plonger les cours mais seulement pour un temps. En 2011 lors des printemps arabes, les prix du baril se sont envolés à 120 dollars début 2011.
Une autre onde de choc s’est produite en 2019 lorsqu’une attaque de drone menée par l’Iran a visé les installations saoudiennes stratégiques d’Abqaiq et Khurais entraînant soudain la perte de production de 5,7 millions de barils par jour. En une seule journée, les prix sont passés de 60 à 72 dollars par baril, la plus forte hausse en une seule séance de cotation depuis la guerre du Golfe de 1991.
Plus grande diversité de l’offre mondiale de pétrole
Mais depuis 2023, les choses ont changé. L’attaque du Hamas en Israël du 7 octobre 2023 a eu un impact très passager. Les cours du baril sont passés de 80 à 90 dollars en l’espace d’une semaine avant de refluer. La tendance a été la même à la suite de l’attaque israélienne du 13 juin 2025 contre la République islamique d’Iran. Les prix du pétrole ont augmenté modestement de 7% au cours de la première semaine avant de refluer dès la deuxième semaine. Et pourtant l’Iran possède les quatrièmes réserves mondiales de pétrole et les deuxièmes de gaz naturel. Sa position géographique lui donne la possibilité de fermer le détroit d’Ormuz par où transite environ 20% de l’approvisionnement mondial en pétrole.
En fait, le marché mondial de l’énergie a beaucoup changé au cours des dernières années ce qui le rend moins sensible aux soubresauts géopolitiques du Moyen-Orient. Cela tient à la plus grande diversité de l’offre mondiale de pétrole avec la montée en puissance de pays producteurs comme le Brésil, le Guyana, la Namibie et surtout les Etats-Unis, la constitution de réserves stratégiques qui permettent de faire face aux crises et la moindre dépendance aux importations de pétrole de certains pays occidentaux qui diversifient leurs sources d’énergie.