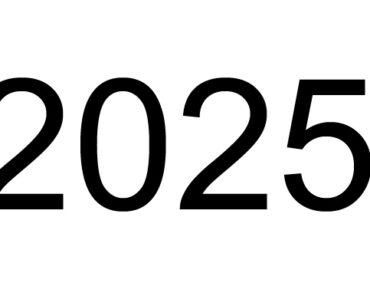À première vue, la transition énergétique semble être aujourd’hui dans une impasse. Les combustibles fossiles dominent toujours de façon écrasante et leur croissance annuelle, en termes de quantité d’énergie supplémentaire disponible chaque année, reste supérieure à celle des énergies bas-carbone. En outre, le vent politique a tourné contre la transition depuis que les crises géopolitiques et commerciales se succèdent. Il y a un élément qui ne trompe pas. Les gros titres des médias consacrés à l’énergie se concentrent aujourd’hui sur l’impact des conflits militaires et économiques et les coûts.
Pourtant, derrière ce brouhaha, les évolutions de fond se poursuivent. Les sources d’énergies décarbonées (renouvelables, nucléaire) continuent à se développer, tandis que le rythme de croissance des énergies fossiles diminue. L’an dernier, les investissements dans le monde dans les domaines liés au climat ont atteint plus de 1 300 milliards de dollars, aussi bien dans les énergies renouvelables que le reboisement.
La frustration vient du fait que les combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz) fournissent encore environ 80 % de l’énergie primaire consommée dans le monde. Et le moins que l’on puisse dire est que l’évolution est très lente par rapport aux 85 % de 1990. Sans dramatiser, ce qui s’est passé jusqu’à aujourd’hui dans le monde n’est pas une transition énergétique mais une addition énergétique.
Prendre ses désirs pour la réalité
Mais cela ne devrait pas être une surprise. Le problème ne tient pas au rythme de la transition, mais au fait que depuis des années militants, ONG, institutions internationales, gouvernements dits progressistes et médias complaisants ont pris leurs désirs pour la réalité. Ils ont cru qu’agiter soir et matin le spectre de la catastrophe climatique allait changer l’économie mondiale et balayer des infrastructures et des systèmes financés et construits pendant des décennies et indispensables à la survie de 8 milliards d’êtres humains.
Les élites politiques et intellectuelles sont aujourd’hui trop souvent éloignées des réalités de la production industrielle comme agricole et des technologies. Ils imaginent que ce qui fait réellement fonctionner notre monde peut se remplacer en quelques années comme on change de version d’un logiciel.
L’objet de la transition énergétique est de remplacer la majeure partie du système énergétique actuel par un système totalement différent. Tout au long de l’histoire, aucune source d’énergie, y compris la biomasse traditionnelle issue du bois et des déchets, n’a connu de déclin mondial en termes absolus sur une longue période.
Un coût exorbitant
L’an dernier, la production mondiale d’électricité éolienne et solaire a atteint des niveaux records. Elle est passée au cours des quinze dernières années de pratiquement zéro à 15 % de la production mondiale d’électricité et le prix des panneaux solaires s’est effondré de près de 90 %. Pourtant, 2024 a également été une année record pour les fossiles. La quantité d’énergie produite à partir du pétrole, du charbon et du gaz naturel a aussi atteint des niveaux sans précédent.
Le problème réside, en partie, dans le fait que nous ne disposons pas toujours des technologies de substitution nécessaires ou qu’elles sont insuffisamment développées et compétitives. Mais surtout, le principal obstacle est le coût exorbitant de la transition : plusieurs milliers de milliards de dollars sans que l’on sache qui devra les payer.
Les donneurs de leçons, qui ne sont jamais les payeurs, ne comprennent pas en outre une question essentielle : les objectifs climatiques n’existent pas dans l’absolu. Ils coexistent avec d’autres impératifs allant de la croissance et du développement économiques à la sécurité d’approvisionnement énergétique. Ils sont en outre rendus encore plus difficiles à affronter par la montée des tensions géopolitiques entre l’Est et l’Ouest et entre le Nord et le Sud.
Réorganiser l’économie mondiale
Pour finir, les modèles et les stratégies de transition construits par les décideurs politiques, les technocrates, les chefs d’entreprise, les universitaires, les militants… partent du principe que les transformations seront rapides, linéaires et régulières.
Cela est impossible. Elles ne peuvent être que multidimensionnelles, différentes selon les régions du monde, à des rythmes inégaux, avec des combinaisons différentes de combustibles et de technologies. Rien à voir avec des modèles rigides et impératifs dictés par des armées de technocrates. La transition énergétique n’est pas seulement une question d’énergie. Elle implique de repenser et de réorganiser l’ensemble de l’économie mondiale. Et cela ne se fera certainement pas par une planification à la soviétique…
Tout cela ne signifie pas que la transition ne va pas se faire et ne se fait pas en ce moment. C’est ce que tente de démontrer Michael Liebreich, fondateur du très influent think tank Bloomberg New Energy Foundation (NEF). Il souligne dans un article récent que les renouvelables se développent aujourd’hui plus rapidement que la demande d’énergie dans le monde, notamment dans les domaines de la production d’électricité et des transports. Tout est une question de taux de croissance. Si cette tendance se poursuit, les combustibles fossiles finiront par voir leur déclin relatif s’accélérer, même si leur production absolue ne baisse pas vraiment dans un premier temps. Quand on analyse la transition énergétique, il faut penser tortue et non lièvre, propose Michael Liebreich.
Son raisonnement est le suivant. L’économie mondiale connaît une croissance annuelle de 3,3 % depuis vingt-cinq ans. Supposons que cette tendance se poursuive. Supposons également que les progrès passés de 1,3 % par an de l’efficacité énergétique continuent également. Cela laisse une croissance annuelle de 2 % de la demande en énergie. Supposons toujours que les sources d’énergies décarbonées, renouvelables et nucléaires, partant du niveau actuel de 30 %, connaissent un taux de croissance moyen prudent de 5 % par an au cours des prochaines décennies. La transition se fera naturellement !
Des projections à prendre avec précaution
Au cours des dix prochaines années, l’utilisation des combustibles fossiles continuera d’augmenter, mais leur part dans la consommation d’énergie réelle baissera de 70 % à un peu moins de 60 % (selon les chiffres de Michael Liebreich).
Avançons encore de dix ans. En 2045, avec une croissance annuelle de l’énergie bas-carbone supérieure de 3 % à la demande énergétique, la consommation de combustibles fossiles baisse cette fois en volume en dessous de son niveau de 2025, mais seulement de 8 %. À cette date, l’économie mondiale consomme près de 50 % d’énergie en plus par rapport à aujourd’hui, comme le prévoient tous les modèles, mais moins de la moitié provient des combustibles fossiles.
Une décennie plus tard, en 2055, l’utilisation des combustibles fossiles a diminué de 40 %, de sorte qu’elle ne couvre plus qu’un quart de la demande énergétique. Et d’ici 2065, les combustibles fossiles auront disparu…
Ce sont des projections à prendre évidemment avec précaution. La croissance des énergies bas-carbone ne sera pas indéfiniment de 5 % par an. Et il restera une part d’utilisation des combustibles fossiles difficile à réduire. Mais cet exercice montre que dans tous les scénarios où les énergies bas-carbone connaissent une croissance plus rapide que la demande énergétique sur plusieurs décennies, les combustibles fossiles sont finalement évincés du système…