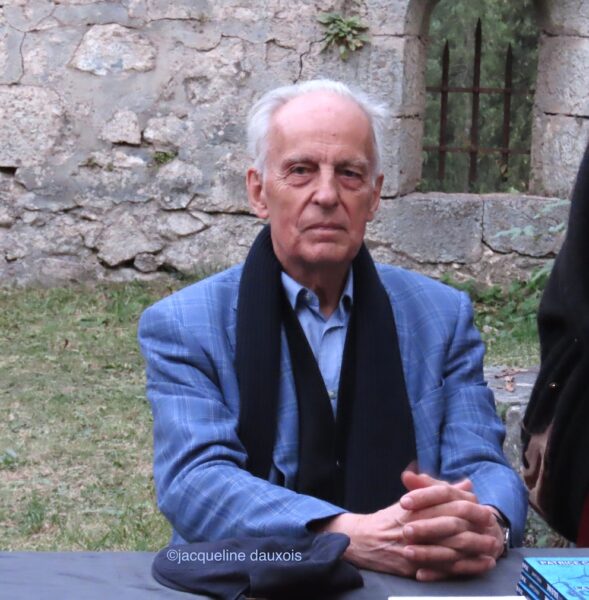
T&E – Les renouvelables intermittents, éolien et solaire, présentent des avantages certains et également des inconvénients comme toutes les sources d’énergie. Les évolutions erratiques des prix de l’électricité en apportent la démonstration tout comme la fragilisation des réseaux. Comment se fait-il qu’il y ait eu pendant autant d’années un déni de réalité sur les renouvelables intermittents, en France et en Europe, et qu’on commence seulement à reconnaître les problèmes qu’ils posent?
P.C. – Je voudrais insister sur l’évolution de l’opinion sur ces sujets même si elle n’est pas forcément partagée par le gouvernement. C’est tout particulièrement le cas sur les énergies renouvelables intermittentes. Il y a une évolution d’abord des tribunaux et de la jurisprudence. Ils sont préoccupés maintenant par la saturation des zones géographiques du fait du grand nombre d’éoliennes et la protection de la biodiversité.
Il y a aussi une prise de conscience du public, même si elle est difficile à quantifier, et des médias. Cela est notamment lié à mon sens à la compréhension de l’impact des intermittents sur le prix de l’électricité qui est considéré à juste raison comme trop élevé. Plus il y a d’éoliennes et de capteurs solaires, plus l’État est obligé de payer des indemnités différentielles, la différence entre les prix garantis qui sont élevés et les prix de marché, et cela se répercute sur le consommateur.
De la même façon, les réseaux reliés à l’éolien et au solaire sont extrêmement ramifiés parce que les équipements sont dispersés dans toute la France et cela coûte très cher. C’est à la charge de RTE, le Réseau de transport d’électricité, et le consommateur paye à la fin.
Il y a un vrai problème. Il est d’autant plus grave que l’avenir de l’industrie française et européenne est en jeu. Entre la France, l’Europe et les États-Unis, la différence de prix de l’énergie pour les industriels est de 1 à 3 en notre défaveur. On n’en était pas très conscient il y a trois ans, mais la fraction éclairée de l’opinion commence à le comprendre.
T&E – C’est d’autant plus incompréhensible que la France n’a pas besoin d’une production électrique massive provenant de nouveaux équipements renouvelables intermittents puisqu’elle a une consommation stagnante et une production très largement excédentaire avec des records d’exportation. Et cette production est décarbonée à 95 % !
P.C. – Juste une remarque sur les exportations, il y a peut-être des naïfs pour imaginer que cela est une bonne chose pour notre balance commerciale. Mais pas du tout. Les exportations se font à des prix de braderie et quand les éoliennes tournent à plein. Nous nous retrouvons avec une production qui dépasse largement les besoins français et vendons notre production excédentaire à n’importe quel prix. Ce système revient à subventionner les économies voisines… C’est absurde.
On peut vraiment s’étonner que compte tenu de tout cela, le gouvernement maintient le cap via le projet de PPE, la Programmation pluriannuelle de l’énergie, la troisième. Il a manifesté très récemment sa volonté de l’infléchir, mais très légèrement et uniquement sous la pression politique notamment du Sénat. Pas sous la pression des réalités énergétiques.
Les ambitions initiales sont d’augmenter les capacités d’éolien terrestre de 68% d’ici 2035. Pour l’éolien marin, on aurait une multiplication par 37 d’ici 2035, c’est effarant mais cela s’explique par une base de départ extrêmement réduite. Pour le solaire, le potentiel installé serait multiplié par 5, ce qui est particulièrement inquiétant, car le solaire est cher, s’agissant de petites installations auxquelles l’État accorde des garanties de prix élevées.
Pour l’heure, le gouvernement ne cède rien sur le fond. Le ministre de l’Industrie et de l’Énergie Marc Ferracci a rejeté toutes les critiques envers l’éolien et le photovoltaïque. Le Premier ministre, François Bayrou, a fait des concessions mais sur le calendrier de la PPE.
Un groupe de travail animé par le sénateur Gremillet (LR) et le député Armand, ancien ministre (Renaissance), remettra un rapport. La proposition de loi Gremillet, adoptée par le Sénat, sera discutée par l’Assemblée en juin. Ce n’est pas une PPE, mais une suite de modifications législatives destinées à obtenir une bonne PPE. Elles essaient de pousser le nucléaire, de relancer l’hydraulique et de promouvoir l’hydrogène vert.
Après le dépôt du rapport Gremillet-Armand, le gouvernement devra accepter des modifications de la PPE. La question est de savoir si elles seront symboliques ou réelles. On peut tout de même avoir des doutes, car le gouvernement a l’intention de faire passer la PPE, même amendée, par décret. Ce qui est irrégulier. Il y a deux articles de loi qui disent bien que les objectifs de programmation de l’énergie se définissent par la loi. Le décret ne peut déterminer que les modalités permettant d’atteindre les objectifs. C’est une règle évidente que le gouvernement ne veut pas suivre de crainte de votes défavorables à l’Assemblée et plus encore au Sénat. Le Premier ministre a bien promis une révision de la PPE. Mais elle est entièrement à la discrétion du gouvernement.
T&E – Le sentiment qu’on a est que le lobby idéologique et économique en faveur des éoliennes et des panneaux solaires a toujours autant de poids politique.
P.C. – Vous avez raison de vous interroger sur les causes de cette obstination du gouvernement. À mon sens, la persistance dans l’erreur est avant tout politique. Elle a deux origines. Il y a d’abord aujourd’hui le « en même temps » macronien. Il y a trois ans, lors de son discours de Belfort qui annonçait la relance du nucléaire, le président de la République était toujours dans le en même temps. Il annonçait la relance du nucléaire, qui en avait bien besoin après la fermeture, de la centrale de Fessenheim, tout en persévérant l’éolien et le solaire. Et puis il y a la nécessité pour le gouvernement de ménager les socialistes acquis par définition aux renouvelables intermittents et qui n’ont toujours pas admis la réalité des problèmes qu’ils posent et des fausses solutions qu’ils offrent aujourd’hui à la France pour résoudre un problème qui n’existe pas. Nous n’avons pas besoin de produire plus d’électricité. Nous n’avons pas besoin de décarboner notre production. Elle l’est déjà.
Après, vous avez des raisons toujours politiques mais plus profondes. C’est-à-dire la présence dans l’État d’une forme aiguë de militantisme en faveur des renouvelables. À commencer par l’Ademe, très grosse agence, 1 000 salariés et un budget de 3,4 milliards d’euros. Elle se consacre en grande partie à la promotion des renouvelables. On a créé à l’intérieur de l’appareil étatique, avec de l’argent public, une grosse machine qui s’est donnée pour mission d’orienter les décisions de l’État. La suppression de l’Ademe proposée par des parlementaires serait à mes yeux une très bonne chose. D’autant plus qu’il y a une interpénétration des personnes entre les ministères, l’Ademe et l’industrie des renouvelables.
T&E – Le modèle tout renouvelables est celui suivi par l’Allemagne depuis plus de deux décennies et qui a échoué comme le reconnaît même à demi-mot le nouveau chancelier Friedrich Merz. Mais cela n’empêche pas les institutions européennes de continuer à vouloir l’imposer. Comment l’expliquez-vous ?
P.C. – Cela s’explique par la prépondérance allemande à Bruxelles. Et Friedrich Merz a un problème qui est qu’il doit gérer une coalition constituée avec les socialistes allemands qui restent partisans des renouvelables intermittents. C’est un petit peu la même situation que celle de notre Premier ministre François Bayrou.















