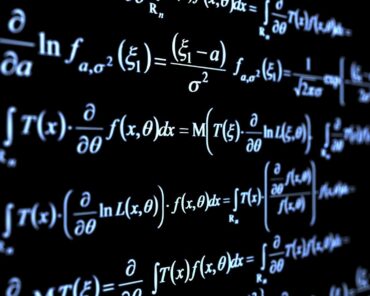La stratégie assumée d’un grand nombre de mouvements écologistes et d’institutions internationales (ONU, GIEC, COP, AIE…) consiste depuis des années à affoler les opinions et les populations sur le dérèglement climatique afin de créer un choc en retour et un sentiment d’urgence absolue. Il s’agit d’obtenir ainsi une mobilisation des sociétés, des médias et des politiques. Si en termes de communication, c’est un succès incontestable, il n’en va pas de même dans la mise en place de politiques et de stratégies réalistes et efficaces et dans l’impact sur la psychologie des foules. Face à un tableau apocalyptique présenté jour après jour, les jeunes générations sombrent souvent dans le nihilisme, l’apathie, le refus de se projeter dans l’avenir ou la radicalité d’actions militantes et violentes.
La licence morale que s’accordent les activistes scientifiques ou politiques repose sur la conviction qu’ils œuvrent pour le bien. Mentir et déformer la réalité est justifié à leurs yeux parce que leur mission sacrée est de prendre des décisions au nom des autres. Ce qu’on appelait autrefois de « pieux mensonges ».
De rares aveux
Parfois, rarement, les décideurs en question avouent. Le docteur Stephen Schneider de l’université de Stanford, membre éminent d’un groupe de travail sur le climat du GIEC, s’était laissé aller il y a déjà quinze ans : « D’une part, en tant que scientifiques, nous sommes liés par l’éthique à la méthode scientifique, promettant en fait de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, ce qui signifie que nous devons inclure tous les doutes, les mises en garde, les “si”, les “et” et les “mais”. D’autre part, nous ne sommes pas seulement des scientifiques, mais aussi des êtres humains. Et comme la plupart des gens, nous aimerions que le monde soit meilleur, ce qui, dans ce contexte, se traduit par notre volonté de réduire le risque d’un changement climatique potentiellement désastreux. Pour ce faire, nous devons obtenir un large soutien et capter l’imagination du public, ce qui implique bien sûr une couverture médiatique importante. Nous devons donc proposer des scénarios effrayants, faire des déclarations simplifiées et spectaculaires, et ne pas faire mention de nos doutes éventuels… »
Tout est dit. De la même façon, Hans Joachim Schellnhuber, le père de l’objectif consistant à limiter le réchauffement à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle (avant que l’objectif devienne soudain de 1,5 °C lors de la COP 21 à Paris en 2015), expliquait : « 2 °C est à peu près valable et c’est un chiffre facile à mémoriser pour les hommes politiques… »
Sauver le monde des humains
Bon nombre de médias et de journalistes portent une sérieuse part de responsabilité dans cette situation. Ils servent de porte-voix aux annonces et études plus ou moins crédibles produites à jets continus qui annoncent la fin de la civilisation, des points de non-retour et un dérèglement climatique exponentiel. Ils considèrent, pour la plupart avec sincérité, que lutter contre le réchauffement climatique est leur mission. Il faut sauver l’humanité de son autodestruction. Cela signifie que dénoncer la catastrophe en cours et à venir est un devoir et même une obligation.
Ce qui a donné à la question du dérèglement climatique une dimension morale et quasi religieuse. Du coup, il ne reste plus que les croyants et les non-croyants. Il y a évidemment des nuances idéologiques et politiques. À droite, les plus sceptiques, plus nombreux aux États-Unis qu’en France et en Europe, nient une réalité scientifique qui n’est pas contestée – à savoir que les influences humaines ont un impact sur le réchauffement – et exploitent les incertitudes bien réelles des modèles climatologiques. À gauche, on trouve inacceptable de reconnaître ces incertitudes et les faiblesses des modèles. On préfère répéter que la science « a tranché » et quiconque émet des doutes est catalogué comme étant climato-sceptique, l’équivalent du négationnisme.
« Un nouveau genre scientifique »
Maintenant, les faits sont têtus, la stratégie de la peur est dangereuse parce qu’elle tétanise et elle est surtout inefficace. Aujourd’hui, 82 % de l’énergie primaire consommée dans le monde provient des combustibles fossiles. Ce chiffre était de 86 % il y a vingt-cinq ans. On peut considérer cela comme très insuffisant mais estimer qu’il y a tout de même un progrès. Pas du tout. La consommation de carburants fossiles a considérablement augmenté depuis un quart de siècle parce que la demande d’énergie s’est également envolée provenant d’une population mondiale qui a fortement augmenté tout comme son niveau de vie moyen. Voilà pourquoi cette année devrait être marquée par des records de production de charbon, de pétrole et de gaz naturel… et donc des records d’émissions de gaz à effet de serre.
Nous avons assisté depuis plusieurs années comme le décrit Vaclav Smil, l’un des plus grands spécialistes universitaires de l’énergie, « à la naissance d’un nouveau genre scientifique dans lequel de fortes doses de vœux pieux sont mélangés à quelques faits solides ». La recette du désastre. Pour réussir la transition, nous avons besoin avant tout de faits justes et précis même si cela n’a pas le pouvoir d’attraction de l’annonce de la fin du monde. Il faut s’accrocher à la réalité même si elle est contradictoire et complexe.
Un monde fini ne peut pas supporter une croissance infinie
Le monde réel fonctionne à partir des lois physiques de la thermodynamique et de la conversion d’énergie. La croissance économique alimentée par une consommation grandissante d’énergie a permis des avancées sans précédents dans l’histoire de l’humanité depuis quatre-vingts ans. Elles vont, entre autres, d’une augmentation spectaculaire de la production alimentaire à une progression tout aussi spectaculaire de l’espérance de vie en passant par un accès presque universel à la connaissance.
Maintenant, l’autre facette de cette réalité est qu’un monde fini ne peut pas supporter une croissance infinie quelles que soient les avancées technologique et scientifiques. Nous avons notamment besoin pour vivre et survivre d’une biosphère en bon état.
Appauvrissement généralisé pendant un quart de siècle
Pour autant, la décarbonation des économies d’ici 2050 en substituant des énergies bas-carbone aux combustibles fossiles est impossible dans des conditions acceptables socialement, politiquement et économiquement. Sauf à connaître une récession permanente et un appauvrissement généralisé pendant un quart de siècle.
Il y a tout simplement une échelle des changements à effectuer qui est indépassable. On ne remplace pas plus de 10 milliards de tonnes d’énergies fossiles consommées sur Terre tous les ans par des renouvelables intermittents et de l’hydrogène en un peu plus de deux décennies. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas le faire. Mais qu’il y a une échelle de temps incompressible pour y parvenir et elle ne disparaîtra pas en répandant la peur et en terrorisant la jeunesse. Cela ne marche pas…